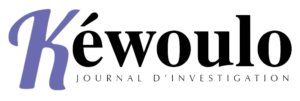Photo: iStock Pour Nelson Charest, la question de la structure des administrations universitaires et le clientélisme qui afflige les universités sont aujourd’hui les plus importantes menaces à la liberté universitaire.
La stupeur, l’incompréhension, un fort sentiment d’absurde, d’injustice et surtout d’ « absolue incrédulité ». C’est ce qu’ont éprouvé en 2020, au cœur de la tempête, la plupart des 34 professeurs de l’Université d’Ottawa qui ont pris publiquement la défense de Verushka Lieutenant-Duval.
Rappelons-nous : le 23 septembre 2020, cette chargée de cours en arts visuels a « prononcé » le mot en n (en anglais) dans le cadre de la deuxième séance du cours Art and Gender, donné à distance, afin d’expliquer à ses étudiants un concept théorique — la « resignification subversive ». Le 2 octobre, après qu’une plainte eut été formulée, la professeure a été suspendue par le doyen de la Faculté des arts, sans jamais avoir pu faire entendre sa version de l’histoire.
L’affaire, rendue publique, a rapidement suscité l’indignation de 34 professeurs de l’Université d’Ottawa, qui ont réagi le 16 octobre dans une lettre ouverte, où ils exprimaient leur désaccord face au traitement réservé par l’Université à Verushka Lieutenant-Duval, tout en défendant les principes de la liberté universitaire.
Mal leur en a pris. Une virulente campagne de cyberintimidation s’est mise à déferler, menée par des étudiants et des collègues croyant appartenir au « camp du Bien », tous aussi militants qu’indignés. Si certains en appelaient à la « rééducation », d’autres les ont accusés de défendre « aveuglément » la liberté universitaire ou n’ont pas hésité à qualifier de « suprémacistes blancs » les 34 signataires — dont la plupart se croyaient pourtant progressistes, de gauche et antiracistes.
Pour essayer de comprendre ce qui a eu lieu, pour documenter les événements et tenter aussi d’exorciser par la parole cette « crise » est née l’idée d’un collectif. Libertés malmenées. Chronique d’une année trouble à l’Université d’Ottawa rassemble aujourd’hui une douzaine de textes autour de ce qui est aujourd’hui connu comme l’ « affaire Lieutenant-Duval ».
« L’affaire Lieutenant-Duval »
« C’est un peu particulier, parce que ce n’est pas le travail auquel on est habitués, qui est plus objectif, plus distancié, confie Nelson Charest, professeur agrégé, rattaché au Département de français de l’Université d’Ottawa. On savait qu’il nous fallait aussi témoigner, mais on a essayé de le faire avec une espèce de juste mesure : témoigner personnellement, mais avec le regard universitaire qui est le nôtre. »
Le professeur Charest fait partie du « groupe des 34 », qui s’est réduit au fil de quelques défections à un noyau d’une vingtaine de professeurs, et signe l’un des douze textes du collectif — qui compte en plus une minutieuse chronologie des événements. « Il y a aussi un aspect presque thérapeutique pour nous. On avait l’impression qu’on avait été au centre d’une crise, sans nécessairement en faire partie. » Une crise qui a, pour l’essentiel, opposé, rappelle-t-il, l’administration de l’Université d’Ottawa à Verushka Lieutenant-Duval.
« Je ne suis pas habitué à penser à coups d’impératifs », reconnaît-il. Prendre de la distance, considérer les choses de manière calme et posée, voilà plutôt l’esprit qui a guidé la rédaction de ces textes, nourris par l’envie de faire quelque chose de constructif.
Selon le professeur, cette tempête a été exacerbée par de nombreux facteurs : le contexte pandémique et les problèmes de santé mentale entraînés par le confinement, le meurtre de George Floyd et la mort de Joyce Echaquan, une administration universitaire pratiquant une « gouvernance arbitraire », ainsi que la réalité non seulement bilingue de l’Université d’Ottawa, mais aussi « biculturelle ». Avec un soupçon de francophobie, transparente sous la forme d’insultes haineuses, comme « Fucking Frogs ». Sans oublier, bien sûr, la présence de plus en plus importante des enseignants à statut précaire à l’Université d’Ottawa.
Aux yeux de Nelson Charest, frappé comme plusieurs de ses collègues par le manichéisme et l’absence de retenue dans les attaques, ce sont les principaux ingrédients du « chaos » qui a prévalu au cours de l’automne 2020.
« La liberté universitaire fait partie de mon modus operandi : je baigne là-dedans. Pour moi, il y avait un caractère d’évidence », dit Nelson Charest, qui avoue toutefois avoir été surpris de l’introduction du racisme et de l’antiracisme dans le débat par la suite. Même si un certain mot a été prononcé, dans un cadre universitaire avec « traumavertissement » dans le plan de cours et tous les guillemets possibles.
« Si j’enseigne Putain, de Nelly Arcan, et que vous me présentez comme un promoteur de la prostitution, je ne vais pas comprendre. Mais, pour tout dire, la liberté universitaire n’était pas mon enjeu premier. C’était d’abord et avant tout une question de droit du travail. La question d’un chargé de cours qui n’est pas défendu par son administration. À partir de là, moi, je n’ai plus besoin de réfléchir. Je dois prendre position. »
Clientélisme à l’université
C’est le principe qui a guidé la démarche de ces professeurs, souvent engagés dans leur parcours personnel et universitaire en faveur de l’ouverture aux autres cultures et de l’égalité hommes-femmes — pensons seulement à Pierre Anctil ou à Sylvie Paquerot.
Les auteurs des textes de Libertés malmenées s’y questionnent sur les pièges de l’autocensure et essaient de réfléchir aux conséquences de cette crise sur leur discipline. D’autres n’hésitent pas à montrer du doigt le « wokisme » et la « critical race theory », qui seraient aux sources de la « puissante vague de déraison » qui frappe depuis quelques années bien des universités en Amérique du Nord.
En son cœur, Libertés malmenées porte aussi un long entretien avec Verushka Lieutenant-Duval, dans lequel elle raconte, encore traumatisée par les événements, avoir depuis renoncé à enseigner en anglais (elle qui a pourtant été formée à Bishop et à Concordia). Elle confie aussi avoir « sérieusement » pensé au suicide. Elle a été et demeure, rappelle François Charbonneau dans le texte qu’il consacre aux événements, « la seule véritable victime de cette affaire ».
Pour Nelson Charest, comme pour la plupart des membres du groupe des 34, au-delà du militantisme de quelques étudiants (admirable à certains égards), la responsabilité de l’Université d’Ottawa dans cette affaire ne fait aucun doute, et elle est totale. La question de la structure des administrations universitaires et le clientélisme qui afflige les universités sont aujourd’hui les plus importantes menaces à la liberté universitaire.
« L’indépendance des établissements est très liée à la question de la liberté universitaire, poursuit Nelson Charest. Il y a encore localement des connivences entre des associations universitaires et certaines compagnies, mais ce qui est plus grave encore à mon sens, ce qui est plus subtil et plus pervers, c’est qu’il y a aussi une dépendance envers 1000, 2000, 30 000 payeurs, qui deviennent des bailleurs de fonds. Et c’est là où, à mon sens, ça devient problématique. »
Le Devoir