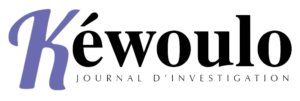En mission d’État, on ne transporte pas ses querelles ; on transporte une image. Et parfois, une phrase prononcée à l’étranger en dit plus long sur un régime que tous les discours officiels.
Mon cher Saa Balaŋaar,
Bassirou m’a transmis ta lettre depuis Ndiarguène, dans le Sabakh. Je l’ai lue lentement, sans hâte, comme on lit un texte qui ne cherche ni l’effet ni la clameur, mais la justesse. Il y a dans tes mots cette gravité tranquille qui appartient aux républicains quand ils sentent qu’une ligne symbolique a été franchie, non dans le fracas, mais dans la légèreté apparente d’une métaphore mal choisie.
Cher Saa,
Tu as raison. Ce qui s’est dit au Maroc n’est pas un simple écart de langage. Et ce n’est pas non plus une critique ordinaire de la Justice, chose légitime dans toute démocratie vivante. Ce qui trouble, profondément, c’est le lieu, le moment et la fonction. Un Premier ministre en mission officielle, dans le cadre solennel d’une Grande Commission mixte, censé incarner la continuité et la retenue de l’État, a choisi d’endosser à nouveau la posture du tribun. Non pour parler de coopération, de projets communs ou d’avenir partagé, mais pour régler, hors de ses frontières, un différend ancien avec une institution centrale de son propre pays.
On ne parle pas de son État à l’étranger comme on parle dans l’arène intérieure. On ne transporte pas ses querelles institutionnelles comme un bagage personnel. À l’extérieur, un responsable d’État n’exporte pas ses colères. Il exporte une image. Et l’image qu’il donne engage bien plus que sa personne ; elle engage la République tout entière.
Tu as souligné avec finesse le danger du glissement sémantique. C’est à-dire transformer les juges en clergé, la Justice en sacristie, le droit en dogme. Tu as raison d’y voir une métaphore dangereuse. Car avant de fragiliser une institution, on commence toujours par la caricaturer. L’histoire est constante sur ce point : on ne détruit pas d’abord les piliers, on les ridiculise.
Permets-moi, cher ami, d’aller un pas plus loin, non pour te corriger, mais pour élargir la perspective.
Il existe, au fondement même de la pensée constitutionnelle moderne, une idée simple et pourtant exigeante : le pouvoir ne se protège pas contre l’erreur par la vertu, mais par la séparation. Montesquieu, que l’on cite souvent sans toujours l’entendre, n’a pas pensé la séparation des pouvoirs pour honorer les juges, encore moins pour sanctifier la Justice. Il l’a pensée pour protéger les citoyens contre les passions de ceux qui gouvernent.
« Il n’y a point de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance exécutrice. »,
Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748.
Non parce que les juges seraient meilleurs, mais parce que l’homme de pouvoir, livré à lui-même, finit toujours par se croire justifié. La Justice indépendante n’est pas un contre-pouvoir hostile ; elle est un pouvoir de retenue. Celui qui la combat ne combat pas une institution. Il combat la retenue elle-même.
C’est ici que le malaise devient profond.
Lorsqu’un exécutif entretient un conflit prolongé, presque intime, avec l’institution chargée de dire le droit, il cesse d’être un réformateur pour devenir un protagoniste. Or l’État ne peut être protagoniste de ses propres procès. Il ne peut être à la fois juge et partie, accusateur et architecte des règles. Ce n’est plus une question de personnes, mais de culture d’État.
Réformer la Justice est une nécessité permanente. L’humilier publiquement, surtout depuis l’étranger, est une faute symbolique. On ne réforme jamais une institution en la désignant comme ennemie morale. On ne la réforme pas davantage en la réduisant à une corporation obscure, arc-boutée sur ses privilèges. La Justice n’est ni pure ni impure. Elle est nécessaire. Et dans une République, le nécessaire doit être protégé même quand il dérange.
Cher Saa Balaŋaar,
Tu l’as rappelé avec justesse. La Justice sénégalaise n’est pas une Église, et l’Église sénégalaise n’est pas un pouvoir politique. Elle s’est construite dans la discrétion, le dialogue et la retenue. Le dialogue islamo-chrétien, qui fait l’exception de ton pays, est un équilibre fragile, patiemment entretenu. Y mêler, même par métaphore, une querelle judiciaire est une imprudence que l’histoire n’excuse jamais. Car les mots ont une mémoire, cher Saa. Ils survivent à ceux qui les prononcent. Les gouvernements passent, les phrases restent. Et il suffit parfois de quelques images répétées – le juge comme clerc, la Justice comme caste – pour installer dans l’esprit public l’idée qu’un pilier peut être contourné, puis déplacé, puis affaibli.
Tu évoques Weimar, et tu fais bien. Les Républiques ne meurent pas toujours sous les coups. Elles s’épuisent souvent dans la confusion des rôles, dans la banalisation des attaques symboliques, dans l’idée que l’on peut « nettoyer » ce qui résiste au nom du peuple. Tocqueville l’avait pressenti en nous disant que la tyrannie moderne ne s’impose pas par la force brute, mais par l’adhésion émotionnelle. Et cette adhésion se fabrique par le langage.
Ce qui me frappe, enfin, c’est ces interrogations que tu poses sans les formuler explicitement. À quelle fin ? À quoi sert d’exposer ainsi la Justice nationale sur une terre d’hospitalité diplomatique ? À convaincre ? À rallier ? À solder un compte ancien ? Je ne m’y risquerai pas. L’histoire n’a pas besoin de nos hypothèses, elle observe les effets.
Et l’effet est clair que lorsqu’un État parle contre lui-même hors de ses frontières, ce n’est plus une critique, c’est une exposition. Or l’exposition fragilise toujours plus qu’elle ne réforme.
Ta lettre, cher Saa, rappelle qu’il existe encore des voix qui préfèrent la gravité à la clameur, la retenue à la mise en scène, la République à l’instant. Depuis Berlin, où les mots ont souvent précédé les ruines, je te le dis sans emphase : les institutions ne demandent pas qu’on les aime, mais qu’on les respecte. Et le respect commence toujours par la mesure du langage.
Transmets, je te prie, mon salut fraternel à Porokhane où est celebrée la Grande Mame Diarra Bousso. La mère du Grand Cheikhoul Khadim dont la vie silencieuse rappelle une vérité que le pouvoir oublie parfois : les œuvres durables naissent moins du fracas que de la transmission. Ce Magal de Porokhane nous rappelle que derrière les grandes figures, il y a souvent une femme debout. Derrière la parole juste, il y a toujours la retenue.
Que la paix du cœur, celle que l’on ne crie pas, continue de guider tes pas. Les Républiques survivent grâce à des hommes qui parlent moins fort que leur conscience.
Ton vieil ami,
Karl