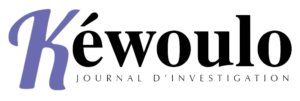Dans un article sur lequel je suis tombé par hasard et intitulé «Les jeunes diolas face à l’exode rural» (ORSTOM, C.R.O.D.T., 1984), Marie-Christine Cormier effleurait, presque par inadvertance, le phénomène asobi pourtant si marquant et si divertissant dans la culture populaire en Casamance en général et chez les femmes diolas en particulier.
Dans cette brève chronique socio-anthropologique, je voudrais revenir sur ce phénomène culturel unique et en faire une présentation succincte concernant ses origines et sur la manière dont il est apparu en Casamance. J’espère surtout que d’autres esprits poursuivront cette présentation dans des travaux plus systématiques. L’origine de l’ossature de nos cultures reste toujours un épais mystère que nous dévons percer pour mieux nous connaitre et mieux avancer sur le chemin de notre destin collectif.
Disons, en gros, que le phénomène nommé assobi est, si on le caractérise de manière grossière en langue wolof, assimilable à ce qu’on appelle niiroolé.
Le terme asobi signifie «uniforme» et vient de la langue yorouba (2e langue parlée à la maison après le Haoussa au Nigeria). Dans cette langue en effet, aso signifie «vêtement» et ebi signifie «famille». Ainsi, aso-ebi peut être traduit par «vêtement familial» ou «uniforme familial», ce vêtement (ou uniforme) familial étant traditionnellement porté, au Nigeria et par certaines populations ouest-africaines sous influence culturelle yorouba (notamment au Benin, au Togo, au Ghana, etc.) durant les cérémonies funéraires, les grands moments festifs (mariage, initiation, baptême, etc.), les cérémonies de deuils, les funérailles, etc.
L’idée de porter un vêtement en uniforme peut être interprété comme une volonté commune d’auto-identification du clan qui s’appuie sur les «vertus africaines de l’âge», du sexe, de la parenté, pour marquer la communauté du territoire partagé et l’unité symbolique autour de celui-ci dans l’espace et le temps.
La culture du coton et l’installation progressive des usines textiles ankara en Afrique noire ont sans doute favorisé l’appropriation du tissu comme outil symbolique servant à donner une intimité nouvelle au du corps mais, également, à servir de nouveau moyen d’expression culturelle de l’identité africaine longtemps niée par le projet colonial.
Dans les colonies britanniques où l’Indirect rule a davantage favorisé l’exploitation économique que l’exploitation culturelle, les dimensions de l’univers symbolique yorouba qui ont échappé au «pillage» colonial ont été réinvestis dans la défense de la culture yorouba. En effet, les Yoroubas se sont appropriés les symboles de la modernité occidentale que sont, entre autres, le textile ankara qu’ils ont d’abord fait leur avant de les retourner, telles des «armes miraculeuses», contre le projet colonial de négation des valeurs fondamentales de la culture africaine yorouba.
Ils ont donc non seulement inventé le aso-ebi pour s’identifier eux-mêmes comme groupe collectif mais ils ont migré progressivement cette pratique culturelle d’auto-identification vers la cellule familiale en la popularisant et en y intégrant les «étrangers» qui peuvent désormais marquer leur appartenance à leurs groupes en portant les vêtements appropriés qui les identifient remarquablement aux familles auxquelles ils se réfèrent. De plus, les Yoroubas se sont employés, à travers les Aku people ou Krioles, qui dominent encore aujourd’hui le négoce et le commerce du tissu au Liberia, en Sierra Leone et en Gambie, à diffuser cette pratique culturelle (l’assobi) dans ces pays, en Casamance et dans la plupart des pays ouest-africains qui jouxtent les Rivières du Sud.
Tissu de fraternité, symbole d’amitié et de partage, l’habit en uniforme assobi n’est pas que paix et concorde contrairement à ce qu’on peut penser. Il peut aussi être un instrument de stratification sociale, un marqueur identitaire, un symbole de compétition et un outil qui permet d’obtenir de l’influence et de la puissance entre les groupes (d’âge, de sexe, de pouvoir, etc.). Et sous ce rapport, il contient tous les ingrédients sociaux qui permettent de jeter le pont entre les sociétés traditionnelles d’essence égalitaire au sud du pays et les «sociétés nouvelles» en gestation désordonnée qui sont profondément marquées, aujourd’hui en particulier, par la compétition et les inégalités sociales dont il faut ramener les écarts à des proportions qui assurent un commun vouloir vivre ensemble plus acceptable pour tous les citoyens.
Dingass Diédhiou, Ph. D.
Sociologue
Canada