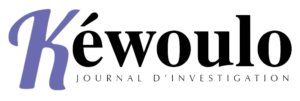On est encore manifestement reparti pour une année scolaire et universitaire agitée. Les syndicats du moyen -secondaire et du supérieur reviennent à la charge pour exiger du gouvernement le respect des « accords conclus » avec comme option proclamée la radicalisation dans les luttes, et comme arme, le recours à la grève.
Personne ne s’y trompe. La logique est simple. 2018 est année pré-électorale. C’est le moment ou jamais de contraindre les pouvoirs publics à céder sur des revendications considérées comme majeures dans le secteur .
Le gouvernement, pour sa part, met en avant les efforts colossaux d’investissements réalisés dans l’enseignement et la formation, dans les carrières et dans la valorisation matérielle et financière de la fonction enseignante .
À dire vrai, personne ne peut contester les acquis de l’école Sénégalaise ces vingt dernières années. Et pourtant le secteur est toujours sous tension et déjà en ébullition avec des risques d’hypothèque sur l’année scolaire et universitaire si des issues ne sont rapidement trouvées pour substituer des démarches positives et sereines de co-responsabilité aux logiques conflictuelles qui, même payantes dans le court terme, présentent l’inconvénient majeur et non gratifiant de conforter dans l’opinion l’idée d’un corps social qui construit son confort sur l’autel de la réussite scolaire et universitaire des enfants et de la jeunesse.
Cette perception qui s’incruste de plus en plus dans la conscience populaire est d’autant plus déplorable que ni cette même opinion, ni l’état ne met en question la légitimité et le bien – fondé des revendications soulevées par les enseignants. Car au fond , ce qui est en jeu dans cette épreuve de force, ce n’est ni la justesse des problèmes soulevés, ni la volonté de leur trouver les solutions attendues ; c’est plutôt sur les échéances de prise en charge que buttent les parties .
La question fondamentale qui se pose à partir de là est de savoir si dans un monde aujourd’hui gouverné par le savoir où les chances de progrès des nations sont fondamentalement fonction des capacités qu’elles se donnent de former des cadres et travailleurs qualifiés, est ce que ceux qui ont choisi d’assurer cette mission ont le droit, pour quelque raison que ce soit, de priver élèves et étudiants d’une seule heure de cours ?
Cette question est d’autant plus essentielle qu’au moment où l’enfant Japonais, né dans un pays post-industriel, est soumis à un rythme scolaire de 1300 heures de cours par an entièrement dispensés dans sa langue maternelle, l’enfant Sénégalais ne bénéficie que de 900 heures de cours, et dans une langue étrangère dont l’apprentissage absorbe la moitié du temps de travail qu’il consacre à l’école élémentaire.
Si pour une raison ou une autre, ce quantum horaire dérisoire, avatar de notre passé de pays colonisé, venait encore à être réduite , en mesure-t-on toutes les conséquences en termes de réussite individuelle, de contribution au bien-être des familles, des communautés et de la société dans son ensemble ?
Chaque heure de cours perdue doit se mesurer en terme d’hypothèque sur la réussite scolaire, sociale et professionnelle du futur citoyen, bâtisseur de nation dont l’enseignant porte la responsabilité de contribuer à l’éducation et d’assurer la formation.
Cette mission mérite bien tous les sacrifices pour une société qui appréhende les enjeux du monde d’aujourd’hui, essentiellement fondé sur l’économie du savoir.
Sous ce rapport, la question du futur de notre nation est indissociable de la question du devenir de notre école, l’école publique en particulier pour la mission essentielle de démocratie sociale qu’elle a historiquement jouée dans notre pays ; et dont la valeur intrinsèque se mesure dans sa capacité à fournir à notre société les moyens culturels, techniques et technologiques de son progrès et de son émancipation.
C’est pourquoi la communauté éducative est de nos jours interpellée dans toutes ses composantes, état , enseignants , société civile pour trouver , à tout prix , les moyens de mettre un terme à cette dialectique infernale, dévastatrice et contre-productive de conflits sans fin dans un secteur aussi stratégique pour le développement de notre pays , en particulier l’école publique qui a offert à chacun de nous la chance d’un statut , chance que nous avons le devoir moral de léguer à nos enfants et petits-enfants , à ceux en particulier dont les parents n’ont pas les moyens d’une alternative autre que la rue .
Pour nous qui avons été parmi les témoins privilégiés de l’évolution du système éducatif de notre pays, ces trente dernières années et des acteurs majeurs dans les luttes démocratiques et sociales pour l’accès universel à l’éducation et pour une fonction enseignante valorisée et digne de la mission qui est confiée par la société, personne n’est mieux placé que nous pour avoir la juste mesure de la longueur du chemin parcouru et de l’étendue des résultats obtenus.
Il y’a lieu toutefois d’accepter qu’entre-temps, notre pays, notre société et le monde dans lequel nous vivons ont connu de bien profondes mutations dans les rapports aux pouvoirs. Les relations entre gouvernants et gouvernés, administrateurs et administrés, dirigeants et citoyens se structurent à travers de nouveaux paradigmes alors que les modes, modalités, instruments et règles de gestion n’ont pas été mis à jour , voire réinventés.
La modeste expérience qui a été la mienne dans la gouvernance d’un secteur social stratégique comme la santé m’a appris qu’il est aujourd’hui un impératif d’engager une réflexion sérieuse sur le mode de gestion politico-administratif de ces départements sur-syndicalisés et à très forte intensité d’employés de haut niveau de qualification.
Cette observation est encore plus actuelle dans le système éducation -formation- recherche où les personnels représentent plus des trois-quarts des effectifs de la fonction publique et dont les charges liées aux traitements absorbent la moitié des recettes fiscales du pays .
Si malgré tout , l’état reconnaît la légitimité et la justesse des revendications soulevées , nous avons là une base tout à fait raisonnable pour négocier dans la sérénité et dans un esprit de co-responsabilité .
Ne nous voilons pas la face. La charge et la complexité des défis à relever au quotidien dans des départements comme l’éducation et la santé sont incompatibles avec une gestion appropriée de crises sociales récurrentes dans ces secteurs stratégiques et névralgiques telles qu’elles s’expriment en permanence sur le champ syndical .
Au delà du gouvernement, il doit être du ressort des forces politiques et sociales liées à la majorité, compagnons démocratiques des décideurs politiques, d’engager un débat de fond sur les réformes en cours et sur les nouveaux organes politico-administratifs de gestion des réformes du système scolaire et universitair, des carrières et des instruments de dialogue social et de négociations entre les parties.
Cette réflexion doit permettre de repenser les outils de gouvernance des secteurs à fort potentiel de conflits et d’arbitrages , en renforçant les pouvoirs et les moyens des organes existants de prévention, de gestion et de règlement des crises , tout en envisageant la création de nouveaux instruments politico-administratifs de co-gestion des réformes.
Les expériences connues dans nombre de pays révèlent l’existence de solutions pertinentes, durables et non budgétaires pour la gestion des problèmes liés aux carrières et aux conditions de travail et de vie des enseignants et de leurs familles à travers le monde .
La perspective de l’émergence du Sénégal avec le capital humain et la capture du dividende démographique comme leviers essentiels ne peut tolérer la persistance de crises permanentes tendant à installer l’école Sénégalaise dans un champ clos de querelles stériles ruineuses pour notre jeunesse et notre société .
La majorité se doit, aux côtés du gouvernement, de se saisir de ce débat pour en faire un sujet national qui requiert la contribution de tous car ce qui est en jeu transcende la majorité qui nous gouverne . C’est bien le devenir de notre nation qui est mis en équation.