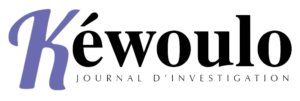Extrait du livre « Côte d’Ivoire, violences d’une transition manquée »,
Edition Paris, l’Harmattan 2007
Auteur: Bacary Touré
Le périple de Banfora: Rencontre avec Dolodougou
J’étais au crépuscule de mon départ de la capitale ivoirienne. Depuis deux semaines, j’avais réduit au minimum mes déplacements dans la ville d’Abidjan. Je m’étais, par prudence, circonscrit dans un périmètre de 5 kilomètres carrés. En dehors des visites quotidiennes que je rendais à Amandine, à la Sicogi de Marcory, mes lieux de fréquentation se résumaient aux centres commerciaux Prima et Cap Sud situés dans le quartier résidentiel de la zone 4. En dehors de ces deux endroits publics où je ne risquais pas grand-chose, je ne sortais pratiquement pas. La peur des corps habillés, accentuée par celle des bandits, avait fini par avoir raison de mon entêtement.
À Abidjan, les malfaiteurs ne subtilisent pas, ils agissent à visage découvert. Et toujours devant leurs victimes. Le braquage est le mode opératoire le plus utilisé par les brigands. La libre circulation des armes légères, entrant facilement par les zones de conflits que constituent la Sierra Leone et le Liberia frontaliers, encouragée par le phénomène de leur vente comme des petits pains dans les black-markets d’Adjamé et de Koumassi, est un problème très sérieux. Si sur le marché noir, le prix d’un pistolet paraît exorbitant, le simple fait de s’inscrire sur la liste des partisans du FPI et promettre fidélité à Gbagbo suffisait à régler le problème.
Ces armes distribuées par le FPI et destinées à tuer les Burkinabé et les Dioula servent, parfois, à d’autres fins. Avant le règne des Refondateurs, loin d’être une ville tranquille, la capitale ivoirienne a toujours été, comme toutes les mégapoles du monde, une ville dangereuse. Mais le record de l’insécurité n’a jamais été aussi grand que sous le règne de Gbagbo. En l’espace d’une année de pouvoir des Refondateurs, Abidjan était devenue un vrai far West et les courses-poursuites agrémentées de coups de feu entre policiers et bandits étaient devenus notre décor au quotidien. Des grands responsables ivoiriens du show-biz n’ont pas été en reste.
Le talentueux chanteur Dézy-champion fut de ceux-là qui ont utilisé leur arme à des fins de brigandage. Adulé et déifié, le jeune homme, dont la voix faisait courir d’immenses foules, a été arrêté pour le délit de vol à main armée et incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan. Ce fut dans cette atmosphère de sauve-qui-peut que j’avais, une dernière fois encore, eu affaire à la gendarmerie ou plutôt aux racketteurs de ce corps. Nous avions, dans la maison où j’habitais, un gardien. Il se nomme Daouda Ouattara. Contrairement au président du RDR, Wat, comme je l’appelais affectueusement, était Koulango et originaire de la ville de Bondoukou.
Les Koulango sont des animistes et la grande majorité de cette population du Nord-Est ivoirien venait, elle aussi, d’accéder à la bonne Parole de l’Évangile. De taille courte et de corpulence moyenne, Wat était de ceux-là dont on dit qu’«ils sont les bienheureux»; car ayant vécu sans haine ni victoire. Il était de ceux-là dont on dit qu’«ils peuvent vivre dans un même trou avec un serpent». L’homme était inoffensif et complètement détourné de tout ce qui fait courir les mortels. Il était de ceux-là qui ne convoitent rien et qui n’ont jamais rien eu, ne se contentant que de ce que le bon Dieu avait bien voulu leur donner. Il était entier dans ses relations.
La franchise et la simplicité dont il s’était fait une religion, l’avaient réduite au simple statut de sujet. Malgré son âge avancé, le vieux, comme on l’appelait parfois, était resté jeune et était l’ami et l’égal de tous les jeunes du quartier. De son poste de garde, dans le grand immeuble où je vivais, il avait vue sur tout. Et il était au courant des frasques de tous les locataires. Des maris infidèles aux épouses adultères en passant par les prostituées occasionnelles, celles qui couchent avec n’importe qui pour régler un problème urgent d’argent. De sa position stratégique, il contrôlait tout et il avait «un cadavre dans le placard» pour chacun des pensionnaires de l’immeuble.
Ce privilège, loin de s’en servir comme une arme, était, au contraire, un poids sur sa conscience. Pour lui, il était au service de ses voisins et ces derniers abusaient de cette sollicitude. Moi en premier. Un jour, revenant de chez Amandine, j’ai trouvé le vieux dormant les poings fermés. Gravissime pour un gardien de nuit, le vieux ronflait comme un soûlard tombé dans les pommes. Marchant sur la pointe des pieds, sans faire le moindre bruit, je m’étais saisi de ses chaussures et de sa lampe-torche et étais remonté les garder dans ma chambre.
Après avoir caché ses affaires, feignant de ne rien comprendre, j’étais ressorti de la maison. Lorsqu’un quart d’heure plus tard, j’étais revenu sur mes pas, j’avais retrouvé le vieux, une machette à la main, le poignard bien en place, entouré d’une demi-douzaine de jeunes, en train de s’expliquer sur un ton colérique. Faisant semblant d’ignorer la raison de cette colère soudaine, je l’ai interpellé.
– Écoute ne m’emmerde pas! Répondit-il en m’évitant du regard.
Tout en insistant sur cet écart de conduite, Wat continuait sur un ton inaudible de dicter sa liste de reproches aux jeunes. Continuant de jouer son jeu, je revins à nouveau à la charge:
– Mais, «le vieux» pourquoi tu me parles sur ce ton? Lui demandai-je
– Écoute ce soir, je ne suis pas dans amusement!
– De quel amusement parles-tu? Que se passe-t-il?
– Ce ne sont pas ces jeunes-là?
– Qu’ont-ils fait?
– Ce sont des voleurs, désormais, ils ne rentreront plus dans cette maison.
– Mais pourquoi qu’ont-ils volé?
– Écoute, ce n’est ton problème, fous-moi le camp».
Ce soir pour la première fois, depuis deux ans, je voyais le vieux fâché. Il était tellement en colère qu’il tremblait de tout son corps. Et bien qu’il essayât de contenir sa colère, sa voix l’avait trahi. À bout de forces, il finit par craquer. Comme un enfant, le vieux finit par se trahir et à se mettre à pleurnicher comme un nourrisson. Tout en pleurant, Wat refusait catégoriquement de dire la raison de cette colère. Car le dire reviendrait à se trahir. Un veilleur de nuit qui se fait voler ses chaussures et sa lampe-torche, c’est très grave. C’est une faute professionnelle très lourdement sanctionnée et le vieux le savait.
C’est comme avoir un frère bandit, un banni, un criminel, tué par la police ou lynché à mort par une foule. On le pleure, mais en silence. Loin d’être insensible au chagrin de Wat, j’avais déjà commencé à avoir de la peine pour lui et je regrettais mon acte. C’était juste une plaisanterie de ma part. Mais comme le dit un adage de chez moi un adulte ne joue pas. Ma plaisanterie était de mauvais goût. Pour la première fois de ma vie, j’avais commis un acte répréhensible et j’avais laissé à un autre le payer à ma place. Ce soir-là, ce furent les jeunes noctambules qui firent les frais de la colère de Wat.
Pendant plus d’une heure Wat resta inconsolable. Pourtant quatre de ces jeunes hommes habitaient l’immeuble. Mais Wat leur avait interdit l’accès de leur chambre. Compréhensifs et peut-être compatissants, ces derniers, sans aucune tentative de résistance et sans savoir l’origine et la raison de cette subite colère, étaient retournés sur leurs pas se trouver un autre gîte pour la nuit.
À mon tour, je cessai de tourner le couteau dans la plaie. Sans bruit, j’étais remonté dans ma chambre écouter le Compact Disc de Kanem que je venais d’acheter au centre commercial Cap sud. Deux heures plus tard, après m’être assuré que personne ne me verrait et que le vieux se serait certainement assoupi, je revins à nouveau au portail. Comme la première fois, Wat dormait comme un loir. Sans faire de bruit, je déposai ses affaires à ses pieds. Et je remontai dans ma chambre comme j’étais venu.
Le lendemain matin, le ciel était lourd de nuages et Wat, comme à son habitude, était debout avant tout le monde. Il avait, à son réveil, trouvé toutes ses affaires mais, superstitieux, il avait mis ses chaussures à la poubelle et gardé la lampe. Comme personne en dehors de moi ne connaissait la raison de sa colère, je m’étais gardé de l’évoquer. En bon voisin soucieux de la santé et du bien-être de mes semblables, je vins vers lui pour lui demander s’il avait bien dormi.
– «Oui merci, dit-il brièvement.
– Mais Wat que t’est-il arrivé hier soir?
– Ce ne sont pas ces gosses-là!
– Que t’ont-ils fait ces gosses? Lui demandai-je, faisant semblant d’être étonné.
– Écoute, ce n’est pas ton problème.
– Ok tu m’excuses, mais je crois que nous sommes de bons amis, c’est pourquoi je m’inquiète quand je te vois malheureux.
– En tout cas, Dieu a tout vu et il tranchera».
Wat et moi étions de bons amis, mais le fait que j’eusse été témoin de cette scène désobligeante où il avait perdu son calme avait creusé un grand fossé entre nous. Après avoir ri de cette mésaventure de Wat pendant plus d’une semaine, je m’en étais ouvert à ma cousine qui me trouvait ridicule de rire sans raison. Lorsqu’à son tour je lui avais raconté l’histoire, Joana en avait ri aux larmes. Et de bouche à oreille tout l’immeuble fut informé. Pourtant j’avais demandé à Joana de me jurer qu’elle n’en parlerait à personne. Elle aussi avait fait de même avec la personne à qui elle avait raconté l’histoire.
Mais le cercle des confidents, à qui on avait demandé de jurer de ne rien dire, était devenu tellement grand que tout l’immeuble connaissait l’histoire du «gardien qui s’était fait voler ses affaires». Sortie de son cercle de confidents, l’information finalement arriva à son destinataire. Pendant ce temps, le vieux était devenu la risée de tout l’immeuble. Meurtri et offensé, Wat avait juré sur les noms de tous les saints que comptait Bondoukou qu’il aurait sa revanche.
Et, «Kpapatoya» aidant dans tout le voisinage, le vieux avait fini par perdre le respect et la considération dont il bénéficiait auprès des gens. Certains pyromanes, pour mieux mettre le vieux en colère, allaient jusqu’à lui dire que ses chaussures avaient été maraboutées pour lui faire perdre sa place. Pendant ce temps, entre lui et moi, c’était presque une guerre ouverte. Il me snobait, m’évitait et parfois, faisait la sourde oreille à mes salutations.
Un jour où, après avoir raccompagné Amandine, je revenais tranquillement chez moi. Soudain, devant mon immeuble, je me suis retrouvé au beau milieu d’un périmètre sécuritaire encerclé par des gendarmes. Après m’avoir interpellé, les gendarmes me demandèrent mes papiers. Étant arrêté devant ma maison, je m’excusé auprès de celui qui m’était apparu comme le chef et lui ai dis que j’habitais l’immeuble.
Compréhensif, il accepta mes excuses. Mais, pour se faire une religion, il a décida de vérifier ma version. En compagnie de ces gendarmes chargés de vérifier si j’habitais réellement la maison, je retrouvai la porte principale close. Après un coup au portail, Wat apparut et se mit à saluer respectueusement les bérets rouges. Ces derniers lui rendant le bonsoir lui demandèrent: Le vieux ce jeune homme habite-t-il cet immeuble?
Sans hésiter Wat ferma les yeux. Et, avec conviction, il martela:
- Non hein! Je ne le connais pas, c’est un menteur!
Wat venait d’avoir sa revanche et de fort belle manière. Les saints de Bondoukou ne l’avaient pas abandonné et, Dieu, ce Dieu qu’il avait invité à nous juger avait tranché net en sa faveur. Sans haine et sans rancune, je me suis plié à la volonté des gendarmes et j’ai accepté de me voir mettre les menottes aux poignets. Comme un malfaiteur. Accompagné des gendarmes, je fis le tour de Koumassi à la recherche de nouveaux captifs.
Après avoir passé vingt-quatre heures au camp et payé la somme de 5000 FCFA, j’avais enfin recouvré la liberté. Et, une fois de plus, le titre de «El Hadji» me fut collé. Toute personne qui revenait de la MACA portait ce titre. Parfois la foutaise collective en arrivait à le donner à ceux qui avaient simplement été interpellés. Ce fut mon cas. À mon tour, j’étais, pour presque une semaine, devenu la risée de l’immeuble au grand plaisir de mon meilleur «ennemi», Wat.
Depuis presque une semaine, j’étais complètement coupé de l’extérieur. Pour mettre la main au dernier paragraphe de mon livre, je m’étais cloîtré dans mon appartement secondaire de Williams-ville. Maintenant, je n’avais de contact que mon téléphone et la fréquence de RFI. De cette retraite, seule la nouvelle déclaration de Wade, disant qu’il était convaincu que Gbagbo n’est pas coupable de tout ce dont on l’accuse, avait réussi à me faire sortir de mon mutisme.
Comment le président Wade, après avoir gagné l’estime et la reconnaissance du monde entier au lendemain de sa sortie contre le régime de Gbagbo, pouvait-il se laisser tromper au point de dire que s’il n’était pas président de la République, il porterait sa robe pour aller défendre Laurent Gbagbo devant la Cour internationale de justice, si jamais celui-ci devait faire face à cette institution? Après cette déclaration, petit à petit, les inconditionnels de Wade se résignèrent et acceptèrent qu’aucun sauveur ne viendrait jamais. Wade avait changé de camp! La xénophobie pouvait continuer et les familles des victimes pouvaient continuer à pleurer.
Après cette hibernation volontaire, je m’étais résolu, ce samedi 9 septembre 2001, à rentrer à Koumassi. Heureuse comme un enfant, «mon Bébé» était venue me retrouver à la maison. Après avoir fait une sieste bien méritée, nous nous étions rendus chez mon ami Isidore avec qui nous devions passer le reste de la journée. Comme réveillé d’un cauchemar, j’avais, plus tard, appris dans la journée du dimanche que «Le Lion du Panjshir», «le tenace défenseur de l’Afghanistan», «le stratège de la vallée» durant la guerre des Soviétiques, l’intrépide Ahmed Shah Massoud, venait d’être emporté par des combattants arabes déguisés en journalistes occidentaux pour l’approcher.
Ina lillahi wa ina ileyhi rajjoon ! (De Dieu nous venons et à Lui nous retournerons !)
Dans mon coin, impuissant face à la tournure des choses, je compris que désormais plus rien ne sera comme avant. Deux jours plus tard, j’avais été interpellé par la sonnerie de mon téléphone au moment où j’étais occupé à l’écriture de la dernière page de mon livre. En cette fin de matinée du 11 septembre 2001 Amandine était au bout du fil.
– «Tu es où chéri ? Me demanda-t-elle.
– À la maison bébé. Je viens d’arriver, lui répondis-je
– Ok allume la télé, c’est la fin du monde!
– Quoi?
– Regarde plutôt et surtout, ne bouge pas. Je te rejoins tout à l’heure».
Je me levai brusquement de ma chaise, enfonçai le bouton d’allumage de la télé et m’affalai lourdement dans la chaise.
– «Mon Dieu!»
La dernière prophétie du vieux Mossi venait de se réaliser et venait, pour moi, de sonner la cloche du retour au pays natal. Dans un très beau ciel dégagé venaient de s’incruster deux avions de ligne d’American Airways dans les deux tours jumelles du World Trade Center. À cet instant précis, loin de penser aux milliers de victimes innocentes de cet attentat, j’étais resté médusé devant la beauté et la précision de cette attaque. Loin de voir la conséquence immédiate et future de cet assaut, ébloui devant ce spectacle que les meilleurs metteurs en scène d’Hollywood n’avaient pu imaginer, je m’interpellais et interpellais l’Humanité sur sa responsabilité dans ce massacre.
Pardonnez-moi ma franchise! Mais, autant qu’un technicien ou un amateur du football, je ne peux rester de marbre devant la beauté et la précision d’une technique militaire, surtout si cette stratégie permet de faire mal sans connaître de trop grands dommages. Al Quaïda, si elle existe, venait de donner une nouvelle leçon, au monde. Cheikh Anta Diop disait: l’étudiant le plus nul de la classe, sous la conduite d’un bon professeur, est capable de construire une bombe atomique, même sous un hangar. Mohammed Atta et ses compagnons venaient de lui rendre hommage.
Sans Ètat, ni laboratoire, ils avaient mis à genoux la première puissance du monde. Elle venait d’être vaincue par «une bande de copains fanatisés». Malgré la douleur, je n’avais pu m’empêcher de me souvenir de cette phrase dite deux années plus tôt sur les terres du Niger par le représentant du cheikh Oussama Ben Laden : l’Occident sera frappé par un grand vent fort venu du ciel par la mer.» La CIA, la Centrale d’intelligence américaine, ne pouvait ignorer cette phrase dite dans cette zone qu’elle contrôlait. Alors pourquoi n’a-t-elle rien pu faire pour l’en empêcher? Mystère et boule de gomme. Les bénéfices qui peuvent être tirés des conséquences du 11 septembre valent-ils plus que les milliers de vies détruites?
La collecte des renseignements ne sert à rien si on ne peut donner une note et de la valeur aux informations recueillies. À la veille de l’attaque des nazis contre l’URSS, les alliés, la Grande-Bretagne pour être plus précis, avaient l’information dans son quartier général de renseignements. Mais personne n’avait pris ces informations au sérieux. Aveuglés par le pacte qui unissait l’Allemagne aux Soviétiques, les services pensaient qu’Hitler n’allait jamais rompre ce traité. Toutefois, après plusieurs moments d’hésitation, l’Angleterre cru bon d’avertir les Soviétiques de l’imminence d’une invasion allemande.
Ces derniers, comme les Anglais, n’avaient pas cru à la véracité de cette information et, eux non plus, ne lui avaient accordé aucune importance. Il avait fallu que l’URSS soit attaquée, pour que cette dernière se rendît compte de son erreur et demandât à ce que l’Angleterre lui fournisse toutes les informations qu’elle possédait sur ce projet. Du plus insignifiant au plus grand détail. Demain, dans quinze, trente, cinquante années, si on ouvre les fiches de renseignements du FBI ou de la CIA, on se rendra compte que l’Amérique était avertie et aurait pu éviter cette boucherie si ces services avaient retenu les leçons du passé. En renseignement militaire, on ne néglige aucune piste.
À la veille de cette guerre que vont lancer les Américains contre le terrorisme, je suis de ceux-là qui croient que Al Quaïda, si elle existe, vaincra. Une guerre ne se prépare pas en un jour; c’est sur une longue période qu’elle se fait. Or, l’Amérique, du moins son opinion, ne s’y est jamais préparée. Au moment où elle se targuait de sa position de première puissance de la planète et s’attirait l’antipathie du tiers-monde, les islamistes promettaient le paradis aux jeunes qui en avaient marre de ce monde trop invivable que leur imposait la pensée unique.
Au moment où la délégation américaine narguait les délégués de la diaspora noire, au Sommet sur l’esclavage tenu dans la deuxième semaine du mois de septembre en Afrique du Sud, se peaufinaient dans les coulisses les derniers réglages du 11 septembre. Cette guerre, Al Quaïda si elle existe l’a préparée depuis longtemps et l’Amérique n’a jamais rien fait pour l’empêcher. La CIA comporte, en son sein, pleins de lacunes et ne peut, en aucun cas, être l’obstacle qui prémunira le monde des horreurs du terrorisme. Elle est trop bureaucratique! Et ses hommes, des Américains pour la plupart, sont trop modernes pour infiltrer et recueillir des milieux islamistes, trop rustres, des renseignements capitaux.
Le cheikh Oussama Ben Laden n’est pas un général d’armée que la majorité suit aveuglément. Il ne donne pas d’ordres! Tout combattant formé dans les camps d’entraînement, en Algérie, en Bosnie ou en Afghanistan, s’en va avec en main sa destinée. Chaque combattant qui quitte un camp d’entraînement reçoit, à la fin de sa formation, le droit de se constituer une cellule qui deviendra une organisation. Libre à lui de frapper qui il veut, quand il veut. À condition que ce soit des cibles occidentales et alliées. Al Quaïda, si elle existe, n’est pas un réseau, d’ailleurs le mot veut dire « base ».
Il n’a pas de chef et le cheikh Oussama Ben Laden n’est ni un prophète, ni un général, ni un commandant, il est juste un « frère », comme n’importe qui. Il peut, certes, être un mécène. Mais il est, avant tout, un combattant au même titre que tous les autres qui ont bénéficié d’un entraînement militaire. Cette image que l’administration de Georges Bush veut donner du cheikh Oussama Ben Laden est fausse. Et cette chasse à l’homme, au contraire, en fera un mythe, un exemple. Et personne dans la communauté musulmane qui le soutient passivement, comme dans les autres qui lui sont hostiles, ne veut sa perte. Il ne sera jamais trahi! Quels que soient les millions de dollars offerts!
Mort ou vivant, en liberté ou en captivité, la personne du cheikh Oussama Ben Laden est insignifiante par rapport à la doctrine du combat. L’Amérique se bat contre un ennemi dont elle ne connaît rien, jusqu’à son mode de fonctionnement. En attaquant ouvertement les combattants musulmans ou les terroristes, l’Amérique va classer le monde en deux groupes. Au soir du 11 septembre 2001, les Américains venaient de savoir que la mort qu’ils avaient exportée au Japon, au Vietnam, à Cuba, au Congo, en Angola pouvait les frapper.
À cet instant, j’avais compris que le monde a un nouveau défi. J’avais aussi compris que les “charognards” n’étaient pas qu’Ivoiriens. Le règne des “charognards” a de beaux jours devant lui! L’ennemi de l’humanité n’était plus la pauvreté, il a changé de visage! Désormais, il est insolent, incontrôlable, sans pays et il n’a pas de visage. Il se nomme terrorisme!
Au soir de ce 11 septembre 2001, je fis mes adieux à Amandine. Loin de tout tapage et de tout romantisme car les cœurs n’étaient nullement à la fête, je fis venir ma douce dans ma chambre et lui tins ce langage.
– «Mon amour, ce soir, il va falloir que tu m’écoutes. Et que, patiemment, nous prenions la responsabilité de ce que nous ferons de notre vie. Après avoir vu ce que j’ai vécu dans ce pays, je crois que l’heure est venue, pour moi, de rentrer chez moi, au Sénégal. Je sais que c’est dur mais il le faut. Comme tu me l’as dit au téléphone, «la fin du monde» est proche. Et je voudrais, à l’heure fatidique, pouvoir regarder, les miens, droit dans les yeux.
– Les tiens?
– Oui chérie, le Sénégal m’attend. Ma mère m’attend, mes frères et sœurs m’attendent. J’aimerais être là, lorsque mon pays aura besoin de moi.
– Ton pays? Quel pays?
– Oui mon amour, j’ai un pays et au cas où tu l’aurais oublié, il se nomme le Sénégal.
– Mais Alex, au cas où, toi aussi tu l’aurais oublié, tu m’as promis que jamais nous nous quitterions. Tu m’as dit que je suis ta seule famille et que personne, ni rien, ne nous éloignerait l’un de l’autre.»
Amandine avait raison ! Je me rappelle ce fameux soir quand, après une nuit torride d’amour, blottie dans mes bras, elle avait éclaté en sanglots. Ayant appris qu’elle est devenue femme, elle m’avait demandé de lui promettre qu’après lui avoir fait connaître ce monde des plaisirs interdits, je ne l’abandonnerais jamais.
Enivré par cette nuit d’amour dont je ne me remettais pas encore, j’avais cru et lui avais dit que jamais je ne partirais sans elle. Je lui avais juré fidélité, comme à une religion. Et Dieu sait que jamais je ne pensais renier cette promesse faite à une femme encore couchée sur le sang de son sacrifice. À cet instant, ma joie et le bonheur d’Amandine étaient tellement forts que si elle me l’avait demandé, je lui aurais promis le paradis sans en être le propriétaire.
Plus tard, j’ai appris, par une de mes copines sénégalaises, que le moment propice pour demander des faveurs à un homme, c’est après une séance réussie d’amour. Ce soir, contre toute attente, Amandine venait de comprendre que la promesse d’un homme, encore dans les étoiles, ne vaut pas grand-chose.
- Vous êtes tous pareils. On me l’avait dit, tous les hommes sont des menteurs, mais je croyais que tu n’en faisais pas partie. Je ne voulais pas que tu en fasses partie. Je te croyais exceptionnel, mais tu ne vaux rien.
Après ces mots, Amandine s’était levée, avait traversé la chambre et, d’un trait, elle s’était retrouvée de l’autre côté de la rue. Elle avait parcouru le kilomètre qui séparait son domicile de ce lieu sans jamais se retourner. Sorti de chez moi, j’avais refait face à ma conscience. À cet instant, j’avais compris que je venais de détruire une vie, celle d’une innocente. Mais que pouvais-je faire d’autre?













![[Billet d’humour] Le Maroc réussit sa panenka… carcérale !](https://i0.wp.com/kewoulo.info/wp-content/uploads/2026/02/suporter-senegal.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)