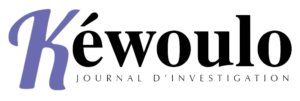Depuis 2009, les habitants de la région de Varela, sur le littoral nord de la Guinée Bissau, sont confrontés à l’exploitation des sables riches en zircon et autres minéraux de la bande côtière. Ils ont vu d’abord arriver des Russes, la société Potosarl, puis plus récemment des Chinois, travaillant pour la compagnie multinationale GMG International (FZC) SA. D’un point de vue administratif, ces populations font partie de l’arrondissement de Suzana, dans le département de São Domingo en République de Guinée Bissau. Mais d’un point de vue socio-culturel (ou ethnique), elles appartiennent en grande majorité au groupe diola feloupe, qui chevauche une frontière artificiellement tracée, après la Conférence de Berlin de 1885, par la Convention franco-portugaise du 12 mai 1886. Leur « territoire », forme un « royaume », regroupant une quinzaine de villages (1), reliés à celui de Karuhay, qui fait office de centre spirituel, y compris pour le royaume voisin de Oussouye côté casamançais.
C’est là que j’ai rencontré le roi Simeng Outine, à la porte de son baloba, son bois sacré, où il prie et communique jour et nuit avec des entités appelées ukin (boekinau singulier), mal traduit par les Européens par le terme « fétiche ». En créole portugais, la langue parlée en Guinée Bissau, on parle d’irão. Ces choses, parfois un simple bol en terre renversé, entouré de bâtonnets, recouvert du sang des sacrifices animaux, de liquides alcoolisés ou de poudre de riz, ne font pas l’objet d’un culte en tant que tel. Elles ne sont que la représentation de forces cosmiques, d’esprits intermédiaires envoyés par le Dieu suprême Emitaï pour communiquer avec les humains. Dans le bois sacré, aucun non initié ne peut entrer. Le roi reçoit dans une antichambre sous le couvert forestier, meublée seulement d’une vingtaine de chaises en plastique. Il est accompagné de sa première épouse, la reine Anabela, de son frère aîné Blaise, et d’un de ses conseillers.

Depuis le début de l’exploitation minière, les populations des villages (2) concernés se sont opposées à la destruction de leur environnement par les machines extrayant le zircon à proximité de leurs rizières et de leurs potagers. Elles ont manifesté, alerté les autorités, les ONG. Les femmes, particulièrement combatives (3) ont été à l’avant-garde de la lutte. En avril 2025, la mobilisation a pris une tournure dramatique lorsqu’un groupe de femmes en colère a fait irruption dans les installations de la compagnie GMG International. Il s’en est suivi un incendie dans des circonstances non encore élucidées. Plusieurs personnes ont été arrêtées et mises sous mandat de dépôt pendant une dizaine de jours, dont une manifestante, un chef coutumier, et une italo-guinéenne qui tient un campement touristique à Varela. L’affaire est toujours en cours mais à la suite de cette action, les Chinois ont fait profil bas. Ils ont quitté les lieux, abandonnant les machines calcinées et des tas de zircon sur le sable, sans donner de signes d’une reprise d’activité. Principale source d’inquiétude pour les habitants de la zone, la construction d’une caserne à proximité, dont la taille laisse supposer qu’une centaine d’hommes pourrait l’occuper. Mais les travaux de constructions aussi sont à l’arrêt. Pendant 7 mois, tout semble avoir été suspendu à l’élection présidentielle du 23 novembre 2025, brutalement interrompue par un coup d’État militaire.

Telle est la situation au moment où le roi de Karuhay accepte de me recevoir. Curieusement, ce n’est pas lui qui prend la parole en premier, c’est son frère Blaise Djata, qui répond à mes interrogations sur les conséquences de l’exploitation minière pour sa communauté. Il m’explique que l’extraction du zircon ne menace pas seulement le milieu naturel, elle risque aussi d’empiéter sur des terres à caractère sacré, lieu de résidence d’un ou de plusieurs boekin. « Les Chinois ne sont pas arrivés jusqu’au fétiche. C’est pour cela que les gens se mobilisent. Pour éviter que l’exploitation minière arrive sur le territoire du fétiche », me dit-il. Ainsi, les populations qui s’opposent à l’exploitation minière le font pour une double raison, écologique et spirituelle. Elles ne mesurent pas forcément les conséquences écologiques à long terme, même si elles ont déjà constaté les dégâts sur leur environnement. En revanche, elles savent très bien ce qui risque d’arriver si le boekin est détruit : malheur à la famille qui en est le gardien, et malheur à sa communauté, le village de Tenhate.
Ici, il faut s’arrêter sur les caractéristiques du pouvoir des rois diolas pour mesurer à quel point celui-ci n’a rien à voir avec nos monarchies européennes, ni même avec les républiques parlementaires qui en sont issues (4). Le roi diola est avant tout un gardien des fétiches. Il est l’intercesseur entre le monde des esprits et la communauté humaine. En tant qu’autorité traditionnelle, il est le garant de l’unité du royaume, mais aussi des grands équilibres. C’est lui qui transmet les injonctions des ukin en rapport avec les grands cycles naturels, et qui règle les différends entre individus, familles, ou villages. Mais il n’a pas de pouvoir sur ses sujets, il n’a pas de force coercitive, et il n’est écouté que dans la mesure où les fétiches sont craints.

Le roi de Karuhaye est au service de sa communauté. Il en est même l’esclave, selon le terme consacré, amikeelo, exprimé dans des chants, au moment de la cérémonie d’intronisation. On retrouve, dans cette royauté démocratique, à l’opposé du modèle européen et de sa compétition pour le pouvoir, un peu du « gouverner en obéissant » des mouvements amérindiens. Sauf que chez les Diolas, il n’y a pas de gouvernement proprement dit. Le pouvoir coercitif faible des rois diolas répond à un pouvoir normatif fort, généré par la croyance dans la puissance des fétiches. Les règles de vie et les interdits qu’ils instituent dispensent ainsi d’un appareil répressif propre aux systèmes étatiques.
Après cette entrée en matière, laissée aux bons soins de son frère, le roi Simeng Outine prend enfin la parole, pour faire un petit historique du conflit. Il revient sur l’arrivée des Russes, à partir de 2009, le premier contrat d’exploration, signé après le coup d’Etat de 2012 par le gouvernement de transition du Premier Ministre Rui de Barros. Le roi ne veut pas insister sur les responsables politiques impliqués, mais il est important de noter que le premier permis est accordé par un régime militaire, malgré la décision d’une cour d’appel qui, quelques jours avant le putch, l’avait annulé pour non-respect des règles environnementales (5). A l’époque, il travaillait à Bissau comme surveillant pour une compagnie de sécurité. Il n’était pas encore roi et il participait aux réunions avec les populations opposées à l’exploitation minière. En 2023, il est intronisé. « C’est à partir de ce moment-là que les choses se sont compliquées », reconnaît-il. Des Chinois représentants la compagnie GMG international (FZC) SA, accompagnés de représentants bissau-guinéens et sénégalais viennent le voir, prétendument pour négocier. « Ils ont dit qu’ils étaient venus pour me saluer. Ils se sont présentés comme étant l’entreprise venue faire l’exploitation ». Il leur donne alors sa position. Mais à son grand étonnement, en lisant plus tard leur rapport, il découvre tout autre chose. « Moi je leur ai dit que je devais d’abord parler avec les représentants de l’État, mais dès qu’ils sont partis, ils ont fait un rapport disant que j’étais d’accord », raconte-t-il.
Plus tard, une délégation de députés vient le voir, mais seulement pour lui annoncer que le gouvernement a signé l’accord avec les Chinois. Comme la résistance continue, ils lui demandent de faire en sorte que la population accepte le projet minier. « Alors, j’ai convoqué les chefs de village. La réunion n’a pas duré longtemps parce que personne n’était d’accord. Même les enfants disaient non », continue-t-il. Après la réponse des représentants traditionnels, il a appelé le maire de São Domingo pour l’informer de la position de la population, et lui demander de la transmettre au Président de la République et au Premier Ministre.
Les autorités étatiques imaginaient-elles que le roi pourrait obliger les populations à accepter l’exploitation minière ? C’est ignorer les rapports de pouvoir au sein du système traditionnel diola, et le sens de la souveraineté (plutôt du bas vers le haut que du haut vers le bas). Peu importe la volonté du roi, ce n’est pas cela qui compte. « Je peux évidemment donner mon opinion personnelle, mais je ne peux pas contredire la population. Même au gouverneur, j’ai dit ce que je considérai comme étant la volonté de ma communauté », répète-t-il.
L’arrogance des administrations étatiques vis-à-vis des formes de pouvoir traditionnel, ou le manque de volonté de comprendre, ne date pas d’hier. On retrouve ce genre de méprise à toutes les époques, depuis l’administration coloniale, jusqu’au régime actuel, que l’on peut qualifier de démocratie de façade, sous surveillance des militaires. Au moment de la lutte de libération nationale, dans les années 60-70, les Portugais ont accusé le roi de Karuhay, grand-père de Simeng Outine, de soutenir les combattants. Ils l’ont enlevé pour tenter de le déporter. On raconte que l’avion dans lequel ils l’avaient fait monter n’a jamais réussi à décoller. Mauvais sort ? Mangi, comme on appelle en pays diola de Guinée Bissau la sorcellerie pratiquée par les femmes ? Ou simple panne de moteur ? Toujours est-il que le roi n’est pas censé sortir de son royaume. Cela fait même partie des interdits royaux. Cela n’a pas empêché plus tard Amilcar Cabral, le leader de la lutte indépendantiste, de l’amener à Conakry où il était réfugié.
Les rois aussi peuvent payer un prix lourd pour ne pas avoir respecté les coutumes. Lorsque le père du roi actuel a été élu député du PAIGC, l’ancien parti unique issu de la lutte de libération, cela a été très mal accepté par les conseillers et la population. Car il ne doit pas s’asseoir sur autre chose que le siège royal, un petit tabouret en forme de sablier. Prendre place sur un fauteuil de député était considéré comme une grave atteinte à la culture. Dans la tradition diola, cela peut mener à la mort, de différentes manières occultes, mais officiellement, il est décédé de maladie. Les rois diolas sont donc installés sur des sièges fragiles, symbolisés par cette escabelle à un pied, très inconfortable et peu propice au repos. « L’État ne connaît pas la réalité du pouvoir traditionnel. Il ne sait pas distinguer quel est le rôle du roi. Moi, je n’ai aucun pouvoir sur ma communauté », insiste Simeng Outine.
L’État ne respecte pas plus les populations et les règles de droit en matière de contrats miniers. Le permis d’exploitation a été accordé à la société GMG International (FZC) SA en mai 2023, avant même que l’étude d’impact social et environnemental ait été réalisée. Puis les autorités ont organisé des pseudo-consultations publiques (6). Valentina Cirelli, l’italo-guinéenne installée à Varela, arrêtée pour son soutien aux populations en lutte, y a assisté. « Ils ont fait une seule audience publique et plusieurs petites réunions sans les femmes. J’étais l’unique femme. Ils nous disaient : vous ne pouvez pas dire non », raconte-t-elle. Les représentants de l’État essayaient de freiner l’opposition en échange de promesses de développement : la construction de la route entre Saõ Domingo, l’installation de l’électricité, des investissements dans le centre de santé. Puis en janvier 2024, en guise d’audience publique, les habitants de Nhiquim, le village le plus proche de la mine, reçoivent une convocation leur annonçant qu’ils ont 15 jours pour déguerpir. Ce mépris, et cette absence de prise en considération des besoins des populations est ce qui a provoqué la colère des habitants, et particulièrement des femmes (7).
Le 18 avril 2025, lorsque les populations des trois villages de Nhiquim, Karuhay et Caton ont marché sur la mine, puis ont mis le feu à la drague qui remonte le zircon à la surface, il y avait surtout des femmes dans le cortège. Elles sont regroupées au sein d’organisations cultuelles, mais aussi d’intérêt économique. Elles se rassemblent au sein des bois sacrés, les balobas, pour faire des prières et des offrandes aux fétiches. Dans la culture diola, il existe des ukin, des autels et des bois sacrés exclusivement réservés aux femmes. J’ai rencontré plusieurs d’entre elles, engagées dans la lutte contre la mine de zircon, dont une qui a pris part à la manifestation d’avril dernier. Toutes veulent rester anonymes, par peur de la répression policière. J’ai donc modifié leur prénom.

Fanta, une des leaders d’un groupe de femmes, une mulher grande, m’explique comment fonctionne leur organisation. Avant toute manifestation, les populations se rassemblent. Il y a des réunions de femmes, des réunions d’hommes, et des réunions mixtes. Elles peuvent se tenir à l’intérieur des balobas, ou ailleurs, dans des écoles par exemple. « Dans les balobas, on se réunit surtout pour prier, demander quelque-chose au fétiche. C’est là que nous nous réunissons pour exprimer ce que la communauté veut. Ailleurs, c’est plus pour débattre », m’explique Fanta. Tout le monde peut demander une réunion et décider de l’ordre du jour. « Ce n’est pas le roi, ou une mulher grande qui convoque les réunions. C’est n’importe qui. Si quelqu’un a un problème, on peut se réunir. Bien sûr, la mulher grande aussi peut demander une réunion ». Fanta ne souhaite pas s’exprimer sur la manifestation du 18 avril, d’ailleurs, elle n’y a pas participé. Mais lors des assemblées qui l’ont précédé, certaines personnes ont appelé à brûler les installations minières, « surtout des hommes d’ailleurs », remarque Valentina Cirelli.
Marcelina, elle, a participé à cette marche. Elle assure que les manifestantes n’avaient pas l’intention de provoquer un incendie au départ. Elles voulaient juste discuter avec les Chinois. Mais quand elles sont arrivées, ils ont refusé de sortir de leurs baraquements. Les militaires étaient positionnés tout autour. Il semble que ce soit le geste menaçant de l’un d’entre eux qui ait provoqué la réaction des femmes. « Un militaire a sorti un poignard en déposant son arme par terre », raconte-t-elle. « Pour nous, cela signifiait le combat. Nous nous sommes fâchées, mais nous n’avons pas eu peur. Nous attendions sa réaction. Rien ne s’est passé. C’est à ce moment-là que nous avons décidé d’agir. Nous avons mis le feu à ce moment-là. Un autre militaire a voulu tirer en l’air mais ils ont pris peur ». Il faut préciser cependant que Marcelina se trouvait à l’arrière de la manifestation et n’a pas tout vu. « J’ai vu des gens mettre le feu, mais je ne sais pas comment l’essence est venue », précise-t-elle.

Après cette opération de « désarmement », comme on pourrait la qualifier dans les milieux écologistes radicaux (8), la répression policière et militaire s’est abattue sur le secteur. Elle n’a pas concerné que les participants, mais aussi des personnes supposées avoir soutenu la lutte. C’est ainsi que Valentina Cirelli s’est retrouvée sous les verrous avec le roi du village de Yale, un chef coutumier qui a les mêmes fonctions de gardien de fétiche que le roi de Karuhay, mais de rang inférieur. Le fait qu’une autorité traditionnelle soit arrêtée, sans avoir été impliquée dans l’incendie (il était à des funérailles à ce moment-là), n’est pas anodin. A travers ce personnage, c’est la royauté de Karouhay, en tant que système parallèle et préexistant à l’État moderne, qui était visée.
Sunque Djata, le roi de Yale, a été nommé roi il y a douze ans à la mort de son père. Comme pour le roi de Karuhay, il a hérité de la charge par voie paternelle. Mais cela ne veut pas dire qu’il gardera son titre. C’est désormais au nouveau roi de Karuhay d’introniser les rois des différents villages de son royaume, et il n’est pas sûr qu’il maintienne Sunque sur son siège. Le roi de Yale est gardien de deux fétiches, un pour la famille, situé dans la cour de sa maison, sous un toit de paille, et un autre pour la communauté, qui est consulté de temps en temps « pour savoir ce qu’il faut faire », prendre des décisions qui concerne l’ensemble du village. Le long des murs de la maison se trouvent plusieurs barres de fer, symboles de son statut de « grande de tabanca », de sage du village. « Tous les vieux sont des grandes de tabanca », me dit-il, tout en précisant qu’il faut organiser une cérémonie et dépenser beaucoup d’argent pour acquérir la barre de fer.

Arrêté le lendemain du sabotage de la mine, il a passé 12 jours en prison, ce qui l’a empêché de défricher un terrain avant la saison des pluies. Il n’a rien à voir avec l’incendie de la mine mais selon lui, c’est en sa qualité de roi de Yale qu’il a été arrêté. « Parce je suis considéré comme responsable », dit-il. « Pour les militaires, j’ai accepté que les femmes aillent brûler les machines. Mais les femmes ne m’ont rien dit. Si elles m’en avaient parlé, je n’aurais pas accepté », ajoute-t-il, fort de son autorité. Cependant, il n’est pas sûr que les femmes l’auraient écouté. En milieu diola, elles sont parfaitement autonomes dans les domaines qui leurs sont propres, notamment tout ce qui touche à la reproduction de la vie. « Les femmes sont libres d’agir dans leur domaine même si les hommes ne sont pas d’accord. Chacun est autonome dans son bois sacré », me confie Rita, la veuve d’un grande de tabanca.
Le roi de Karuhay lui-même était dans le collimateur des militaires. Ils sont venus le chercher mais heureusement pour lui, il était à ce moment-là dans le bois sacré pour une cérémonie importante. « C’était choquant, reconnaît-il, car en tant que roi, sortir de mon territoire est un interdit absolu. L’État m’a stigmatisé, car pour le pouvoir central, c’était moi le problème ».
Plus d’un siècle avant lui, le roi Sihalebe d’Oussouye en Casamance, avait connu la même mésaventure pour des raisons similaires. Incapable d’imposer à sa population le paiement d’un tribut exigé par les Français, il avait été accusé de mener la résistance. Arrêté puis transféré à Sedhiou, il avait enfreint involontairement un tabou en sortant de son royaume, et il était mort en cellule dans des circonstances troubles (9).
Les autorités auraient même tenté d’acheter le roi de Karuhay pour le faire changer d’avis. « L’État m’a proposé de l’argent mais j’ai refusé. Maintenant, je me sens en danger, menacé. On me demande de choisir entre l’argent ou la vie », avoue-t-il. Désormais, Simeng Outine ne veut plus discuter de l’exploitation minière avec les autorités. Il se dit « fatigué ». « S’ils viennent à nouveau pour négocier, je leur dirai que je n’ai pas le temps. Parce qu’on ne vient pas discuter en vous mettant un couteau sous la gorge ».

Des femmes et des hommes ont participé à la lutte contre la mine de zircon, mais ce sont les femmes qui se sont montrées les plus combatives. J’ai essayé d’en comprendre les raisons. Fanta, la mulher grande, m’explique qu’« il y a aussi des organisations d’hommes, mais nous sommes plus nombreuses, et le mangi, c’est nous qui le faisons ». Le mangi, ce sont les mauvais sorts, les opérations de sorcellerie par lesquelles elles convoquent les puissances occultes pour faire reculer les étrangers qui viennent fouiller dans les sables de leur terroir. Seules les femmes le pratiquent. Elles se réunissent dans leur bois sacré pour des rites secrets et plantent des fétiches chargés de maléfices dans la dune, près des machines utilisées par les Chinois. « Oui, nous barrons l’exploitation avec les irãos. On en a planté sur les lieux mêmes, mais je ne sais pas s’ils sont restés », reconnaît Marcelina, qui a participé à la dernière manifestation. La semaine compte 6 jours chez les diolas, et le dernier jour est consacré aux prières. « Tous les dimanches de la semaine de 6 jours, nous faisons des cérémonies pour que les Chinois partent. Nous faisons des mangi, toutes les semaines », explique Rita. Et il semble que cela marche. Déjà, les Russes n’en pouvaient plus des manifestations, des cérémonies et des pannes à répétition. Le mangi des femmes a contribué à leur faire jeter l’éponge. Les Chinois aussi ont très peur des femmes, d’autant que le directeur de la mine est mort pendant son séjour à Varela. Ils n’ont pu faire fonctionner leurs machines que par intermittence, contraints d’arrêter à plusieurs reprises sous la pression populaire. Une des hypothèses (non vérifiée) qui circule à Varela à propos de l’incendie, est qu’ils en auraient eu tellement marre qu’ils auraient saboté eux-mêmes les installations pour toucher l’assurance et partir.
Une autre raison pour laquelle les femmes sont les plus actives dans la mobilisation contre la mine tient à leur rôle, traditionnel dans la culture diola, de protectrices du vivant en général. Elles s’attribuent elles-mêmes le soin des humains et de la nature. Ce sont elles qui ont la responsabilité de la riziculture, essentielle à leur alimentation (10). « Les femmes ont compris plus tôt ce qui se passe parce que dans les rizières ont ne récoltait plus rien. Les Russes ont été les premiers. Avec les Chinois, c’était pire », explique Marcelina. Et en réponse à mes interrogations sur le rôle de la femme dans la protection de la nature, elle ajoute : « la femme c’est la maman du monde. C’est elle qui voit ce qu’elle doit faire pour la vie de son enfant. S’il n’y a plus rien à manger pour l’enfant, l’homme n’en sait rien. C’est elle qui s’occupe de la nourriture, qui va chercher à manger. C’est la femme qui garde le grenier à riz, qui doit faire attention aux rendements. Moi, j’ai vu que les rendements diminuaient. L’économie, c’est la femme qui la maintient. L’homme, il va défricher dans la brousse, ou récolter le vin de palme. Quand ça ne va plus, c’est la femme qui sait pourquoi ». Traditionnellement, il existe une répartition claire des rôles dans la société diola. L’homme s’occupe de certaines tâches, mais en règle générale, la bonne marche du foyer, l’intendance, repose sur elles, et en matière d’agriculture, « ce sont les femmes qui savent » (11). « Les hommes aussi s’occupent de la terre. Ce sont eux qui défrichent et qui labourent. Mais ils sont un peu plus négligents, moins sérieux. Ce sont nous les gardiennes de la terre et de la santé », insiste Fanta, la mulher grande.
Les hommes aussi sont conscients des dégâts causés par la mine. Le roi de Karuhay évoque l’érosion côtière, qui attaque les littoraux de Guinée Bissau et du Sénégal, et que l’exploitation minière sur la dune séparant les rizières de l’océan ne fait qu’aggraver. « L’érosion a beaucoup avancé. Il ne reste plus que 500 m avant le village de Varela », déclare Simeng Outine. « J’ai dit aux autorités qu’au lieu d’exploiter le zircon, ils pourraient favoriser le tourisme, ou envoyer les enfants étudier la géologie pour savoir si l’exploitation est bonne ou mauvaise ». Réflexion d’un roi éclairé, bien plus sage que ces autorités étatiques qui n’envisagent que des profits à court terme, et bien loin de l’image d’une royauté archaïque qui colle encore aux systèmes de pouvoir traditionnel. Il condamne cependant les actions de sabotage, par respect des règles morales qui émanent des bois sacrés. « Je ne conseille pas aux gens d’aller détruire les machines. Car si tu es blessé, si tu saignes, tu ne peux pas entrer dans le village. Il est interdit de verser le sang. Je ne conseille pas de participer à des actions violentes », ajoute-t-il.
Le roi de Yale, celui qui a passé 12 jours en prison, dramatise la situation : « l’odeur de cette mine peut tuer, les femmes enceintes ont donné naissance à des enfants malformés. J’ai constaté une augmentation des maladies. Le riz meurt. Les poissons meurent. D’habitude, il y a des petits poissons dans les rizières quand elles sont remplies d’eau, mais quand la mine fonctionnait, ils avaient disparu », affirme-t-il. Malgré cela, il considère que l’heure n’est plus à la mobilisation. « Après mon arrestation, les représentants de la communauté de Yale se sont réunis, avec des compatriotes de Bissau. Ils ont pris la décision de ne plus rien dire. Si les Chinois reviennent, on les laissera faire. La décision a été transmise aux villages de Caton, de Karuhay, de Cassolole et de Nhiquim », assure-t-il. Alors que je m’étonne de les voir baisser les bras, après s’être battus pendant tant d’années, il me répond qu’ils ont peur des militaires. « Et puis, nous sommes pauvres, vous vous êtes à l’étranger. Vous êtes à l’abri. Si vous voulez m’aider à couler du béton dans ma maison pour empêcher que les termites mangent les murs, vous êtes le bienvenu », ajoute-t-il. Il est vrai que la défense de l’environnement n’est pas le seul motif d’opposition à la mine. Il y a aussi les promesses non tenues. L’État perçoit 10 % des recettes de GMG international SA selon les termes du contrat. Mais la population des alentours de Varela manque de tout. Elle n’a toujours pas d’électricité, la région est coupée du monde pendant la saison des pluies car la route n’est pas goudronnée, et les écoles ont été financées par les parents d’élèves. « Il a un centre de santé, mais il n’y a pas de médicaments », se plaint le roi de Yale.

Ce sont pour toutes ces raisons que des personnes issues de la communauté diola feloupe et d’ailleurs, engagées dans la lutte contre le zircon, ont entrepris une démarche, peu commune en Afrique de l’Ouest (12), en vue d’obtenir le statut de peuple autochtone L’idée est apparue dans un rapport d’experts de l’University Network for Human Rights (13) et pourrait faire son chemin. La reconnaissance de ce statut permettrait à ces villageois de s’insérer dans un cadre institutionnel de protection internationale lié aux Nations unies, renforçant ainsi leurs capacités juridiques de défense face aux atteintes à leur environnement, à leurs conditions de vie et à leur culture, comme celles que mènent l’État bissau-guinéen et les compagnies minières sur leur territoire. Ce statut est défini par différents textes internationaux, la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, et au niveau du continent africain, elle est reprise par la résolution 489 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de 2021. Cependant, ces textes sont d’une application difficile en Afrique pour différentes raisons. Soit, ils n’ont pas été ratifiés par les États africains, ce qui est le cas de la Convention 169 de l’OIT, à l’exception de la République centrafricaine. Soit, ils n’ont aucune valeur juridique contraignante, comme la Déclaration des Nations unies de 2007, et son pendant africain, la résolution 489 de la CADHP.
D’autre part, ce statut a peu de chance d’être reconnu par l’État bissau-guinéen, d’autant plus qu’il est gouverné actuellement, et par intermittence, par des militaires qui ne respectent pas même les droits de leurs concitoyens. Néanmoins, ce statut existe à l’échelle internationale, et rien n’empêche les populations, à moins d’une répression militaire féroce, de s’en emparer pour faire avancer leur cause. La Déclaration des Nations unies de 2007 stipule que les peuples autochtones doivent donner leur consentement libre et éclairé « à tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires » (article 32), ce qui n’a pas été le cas jusqu’alors à Varela. Elle indique qu’ils ont le droit de contrôler les territoires qu’ils occupent et utilisent traditionnellement (article 26). Elle précise également que « les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable » (article 20). D’autres dispositions reconnaissent leur droit à la protection de leur environnement, à la préservation de leur culture et de leur structures politiques, économiques et sociales. Les violations de ces droits reconnus internationalement peuvent susciter des condamnations internationales, entraînant le soutien d’ONG qui en ont fait leur cheval de bataille (Survival International, IWGIA, ICRA international, etc.).

Le roi de Karuhay, Simeng Outine, interrogé sur la question, est totalement favorable à cette démarche. Il met en avant les structures politiques traditionnelles des populations feloupes, qui ont préexisté à l’État bissau-guinéen, et leur autonomie en matière économique. « Le peuple diola répond aux critères pour être reconnu comme peuple autochtone. C’est moi, le roi de Karuhay, qui ai l’obligation d’introniser les rois des autres villages. Depuis le village d’Erame jusqu’à la côte, il y a un peuple qui a un territoire et une organisation sociale propres. La population d’ici ne dépend pas de l’État. Elle s’organise toute seule. Elle est déjà autonome. Les écoles sont construites avec l’argent de la communauté et les ONG. Aucune école n’est construite par l’État », affirme-t-il, bien conscient du lien entre les carences de l’État et le repli sur les structures communautaires. Il rejoint ici sans le savoir les réflexions d’un philosophe camerounais, Pascal Touayem, théoricien de l’Etat pluri-ethnique et multinational. « L’espace sociopolitique africain offre, à la suite de la faible capacité étatique d’allocation des utilités de survie au regard du grand nombre, le spectacle de l’accroissement de la valeur des structures ethno-identitaires érigées en espaces viables de sécurisation », écrit-il (14). En d’autres termes, moins l’État est en mesure d’assurer ses obligations sociales vis-à-vis de sa population, plus le terroir et l’appartenance ethnique deviennent importants en tant qu’espaces de sécurité et réseau de solidarité.

La notion de peuple autochtone doit néanmoins être maniée avec prudence dans le contexte africain, dans la mesure où elle recoupe celle d’ethnie et que l’ethnicité reste une problématique souvent mise de côté par les États au nom de la construction d’une identité nationale. La forme État-nation, toute récente puisqu’elle ne date que des indépendances, tend à s’imposer de gré ou de force, mais elle n’efface pas les appartenances anciennes, issues de souverainetés et de loyautés démantelées au moment des invasions coloniales. La question ethnique couve sous le boisseau et peut s’enflammer à tout moment. Pour ne prendre que l’exemple de la Guinée Bissau, la dernière campagne électorale a été marquée par la résurgence de tensions intercommunautaires liées à de supposées persécutions d’officiers militaires, qui auraient été injustement ciblés pour leur appartenance à l’ethnie balante. Plusieurs vidéos, circulant sur les réseaux sociaux montrent des anciens de la communauté menaçant de réagir « pour laver leur honneur » (15). Tous les candidats ont multiplié les déclarations d’apaisement, appelant à préserver l’unité nationale (16). Cela n’a pas empêché Fernando Dias, le probable vainqueur du premier tour de l’élection présidentielle, écarté par le coup d’Etat du 26 novembre 2025, de jouer sur la fibre ethnique, en appelant les balantes à se défendre contre les arrestations arbitraires, et en arborant le bonnet rouge, signe distinctif chez les balantes des initiés ayant effectué le rituel de passage à la maturité.
A l’échelle locale, la ville de Suzana a connu des tensions il y a une vingtaine d’années lorsque les habitants d’un quartier « musulman » (terme qui, en Guinée Bissau, regroupe à la fois des populations peuls et mandingues) ont commencé à construire une mosquée juste à côté d’un bois sacré. Les animistes sont arrivés avec des pelles et des pioches pour tout casser, avant que la police intervienne pour calmer les esprits.
Plus récemment, à Madina Varela, le quartier mandingue (ou musulman) de Varela, des tensions intercommunautaires sont intervenues lorsque certains de ses habitants ont voulu vendre leurs terrains. Or, ces terres sont censées avoir été cédées à leurs ancêtres il y a plusieurs générations par les autorités traditionnelles diolas mais elles sont réputées inaliénables. Ici, le droit foncier coutumier entre en conflit avec la conception moderne de la propriété. Depuis, les Diolas ont mis des limites à l’expansion des Mandingues, et le respect mutuel semble prévaloir. Mais ce genre de situation débouche très souvent, dans tous les pays ayant connu la colonisation et la superposition de deux systèmes juridiques, sur des violences, lorsque les règles traditionnelles du foncier sont bafouées.
La reconnaissance d’un statut de peuple autochtone comporte donc le risque d’une aggravation de ces tensions inter-ethniques, inter-communautaires ou inter-religieuses, s’il se limite à une seule ethnie ou groupe socio-culturel – en l’occurrence le groupe diola feloupe – qui serait distingué ainsi du reste de la population. Ce qui est possible en Amérique latine, ou dans certaines régions isolées d’Afrique, où des groupes autochtones se sont retrouvés au fil des siècles confinés dans des enclaves culturellement homogènes, qu’ils tentent de préserver en obtenant la délimitation d’un territoire spécifique, ou une autonomie, ne l’est pas forcément dans des pays africains comme la Guinée Bissau où le Sénégal, où la tradition d’hospitalité, jointe aux mouvements de population liés à la colonisation, ont conduit à la formation d’une mosaïque socio-culturelle, avec des quartiers ou des villages minoritaires au sein d’une communauté plus large, et des bourgs cosmopolites. Dans certains pays, en Amérique latine notamment, l’autonomie territoriale est reconnue aux peuples autochtones. Mais elle est difficilement praticable dans une région comme celle de Varela. Limitée à l’appartenance à une seule ethnie, elle risque de couper des villages en deux et de diviser des communautés habituées à vivre ensemble. Quant à son application sur la base de choix politiques et économiques (comme les communautés autonomes néo-zapatistes au Mexique), ou de caractéristiques écologiques (concept de bio-région), ou les deux, elle reste encore très utopique.
Consciente de ces risques, l’Union africaine, dans ses réflexions sur l’application du statut de peuple autochtone au continent africain, a émis certaines réserves par rapport à la Déclaration des Nations unies de 2007. Dans un avis juridique de 2019, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (17) souligne l’absence de définition de la notion de peuple autochtone universellement admise, tout en précisant que le terme ne peut signifier en Afrique « premier habitant », puisque tout africain peut se prévaloir de cette caractéristique. Elle ne parle pas d’autonomie territoriale. Elle reconnaît cependant que le droit à l’autodétermination des communautés autochtones peut être admis dans « leurs affaires intérieures et locales », sans que cela remette en cause l’unité et l’intégrité nationale. « L’identification transnationale des communautés autochtones est une réalité africaine pour beaucoup de groupes socio-ethniques », souligne la Commission, et cela ne change rien en matière de citoyenneté et de nationalité.
Ces conclusions ont été reprises dans la Résolution 489 de la CADHP, texte dont les habitants de la région de Varela peuvent se prévaloir pour réclamer le statut de peuple autochtone. L’absence de définition, ici, n’est pas un obstacle dans la mesure où la Commission préconise d’identifier ces peuples et d’en souligner les principales caractéristiques. C’est l’auto-identification et le sentiment d’appartenance qui compte en premier lieu. Il revient ensuite aux populations concernées de remplir ce vide par des définitions qui correspondent à leur histoire et à leurs cultures. Elles peuvent reprendre certaines définitions de l’OIT, en soulignant qu’elles « se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et (…) sont régi(e)s totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale » (art.1). Elles peuvent se déclarer autochtones du fait qu’elles forment un groupe non dominant, voire historiquement dominé et discriminé, qui maintient et reproduit son environnement ancestral de façon distincte du reste de la société. En revanche, elles ne pourront pas spécifier qu’elles descendent de populations qui habitaient le pays ou la région avant la conquête, la colonisation ou l’établissement des frontières nationales, même si c’est effectivement le cas, parce que ce serait contraire à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Il est intéressant de noter que les textes internationaux en vigueur emploient principalement le terme de « peuple », parfois de communauté autochtone, mais jamais celui d’« ethnie ». Le concept, connoté historiquement et lié à la colonisation, est en effet piégé. Bien qu’il soit encore couramment employé, c’est un héritage lourd à porter. Le terme viendrait selon certaines sources de Georges Vacher de Lapouge (18), un anthropologue français de la fin du 19ème siècle, imprégné de thèses racistes et suprématistes blanches. Adepte du darwinisme social, il n’a fait que plaquer l’esprit classificateur des sciences naturelles sur les peuples nouvellement colonisés, étiquetés comme on range des espèces de plantes et d’animaux, et hiérarchisés entre « races ethnographiques » supérieures ou inférieures (19). La mise en pratique du concept d’ethnie par les anciennes administrations coloniales a eu parfois des conséquences désastreuses. D’un coup de baguette magique, des groupes socio-culturels habitués à vivre ensemble, parfois de simples classes ou castes, ou des regroupements tribaux assez flous, se sont transformés en « ethnies », que le colonisateur a utilisées pour mieux asseoir son pouvoir. Il s’est appuyé sur certaines « ethnies », supposées plus adaptées au monde moderne, plus « civilisées » ou plus « policées », pour en administrer d’autres jugées plus « primitives », plus « sauvages » et plus « indociles ». Les diolas de Casamance faisaient partie de cette dernière catégorie. Ce genre de classification s’est maintenue par-delà les indépendances. Elle est à l’origine de situations de discrimination et de nombreux « conflits ethniques », allant même jusqu’au génocide comme au Rwanda.
D’une certaine manière, les colonisateurs ont appliqué aux peuples rencontrés la même conception rigide d’ethnie que celle de nation dans l’idéologie raciste allemande du 19ème siècle, fondée sur une transmission de l’identité par le sang et donc sur l’idée de pureté raciale (20). Conception qui s’est maintenue longtemps au sein de la recherche scientifique, bien que légèrement atténuée et nettoyée de ses scories racialistes, au moins jusqu’à la Deuxième guerre mondiale. Le professeur Bruce J. Berman parlait à son propos de « la vieille sagesse conventionnelle du « primordialisme », selon laquelle les tribus africaines sont des communautés anciennes, stables (si non stagnantes), gouvernées par des coutumes rigides et immuables, séparées clairement et sans ambigüité les unes des autres » (21). Aujourd’hui, la recherche montre au contraire que les groupes socio-culturels étaient mouvants, ils apparaissaient et disparaissaient, changeaient de nom et adaptaient leur culture aux circonstances. « Dans le monde précolonial, la caractéristique la plus frappante des identités et des communautés africaines était leur fluidité, leur hétérogénéité et leur forme hybride ; un monde social composé d’identités multiples, qui se chevauchent et s’alternent, avec des mouvements importants de populations, un brassage des communautés et des emprunts culturels et linguistiques. Les frontières entre les communautés étaient souvent ambigües et les identités variaient selon le contexte (22) », écrit Bruce J. Berman. La région autrefois qualifiée de « Rivières du sud », qui comprend le Sine Saloum et la Casamance au Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry, témoigne toujours du caractère dynamique des différents groupes socio-culturels, des changements qu’ils ont connu en fonction de leurs rencontres, de leurs frictions, ou de leur coexistence pacifique. Il n’y a pas de peuple diola séparé des autres peuples, mais des diolas imbriqués avec des peuls, des mandingues, des baïnouks et des mandjaks, comme des diolas mandinguisés ou des baïnouks diolaïsés. En Guinée Bissau, on appelle cela corda de batata, à l’image des racines de patate douce, qui se ramifient et se mélangent dans la terre. Logiquement, le statut de peuple autochtone aux groupes socio-culturels de cette région devrait reconnaître ce caractère fluide, dynamique, pluriel et sans limite clairement définie.
Il reviendra donc aux populations de la région de Varela de s’autodéterminer et de s’auto-définir comme peuple autochtone en y mettant ce qui correspond le mieux à leur situation. S’il est justifié en Afrique que ce statut soit accordé à des groupes singuliers qui ont été historiquement discriminés, il n’est pas clairement établi que ce soit le cas des feloupes ou des diolas en général. Ce sont plutôt des régions entières, comme la Casamance au Sénégal, ou la région de Suzana en Guinée Bissau, qui peuvent crier à l’injustice, en raison du sous-développement chronique dont elles sont victimes. Il reviendrait donc à toutes les populations touchées par l’exploitation minière, et pas seulement la « nation feloupe », de revendiquer le statut de peuple autochtone, puisqu’elles devraient toutes en obtenir des bénéfices équitables en termes de développement, et devraient toutes avoir le droit à la maîtrise de leur environnement et à une vie digne. Le statut de peuple autochtone reconnu à l’ensemble des populations de la région de Suzana victimes de la destruction de leur environnement, correspondrait ainsi à la réalité multiculturelle de cette région de l’Afrique. Au lieu de s’appuyer sur la notion d’ethnie, il reposerait plutôt sur une volonté commune de vivre ensemble, cimentée par une histoire et un combat commun, – en l’occurrence, la lutte contre le zircon – et renouvelée par un « plébiscite de tous les jours », comme Ernest Renan envisageait l’idée de nation (23).

Les communautés rassemblées sous le statut de peuple autochtone pourraient ainsi revendiquer « le droit à la conservation, au contrôle, à la gestion et à une utilisation durable de leurs ressources naturelles », conformément à l’article 1 de la résolution 489 de la CADHP, c’est-à-dire un droit de regard sur toutes les activités minières, industrielles, économiques qui menacent leur environnement. Elles pourraient réclamer le renforcement de « la gouvernance et des institutions communautaires », tel que prévu à l’article 2, c’est-à-dire la reconnaissance par l’État des normes et lois établies dans le royaume de Karohaye selon les procédures traditionnelles et démocratiques évoquées plus haut, ainsi que le respect des modus vivendi institués de longue date entre communautés pour éviter ou régler les conflits, notamment les règles du foncier. Cela suppose que les chefs de village mandingues et peuls participent aux assemblées communautaires et renforcent les liens déjà établis avec le roi de Karouhay, comme lorsqu’ils ont pris part aux cérémonies d’intronisation. Il existe des modèles de gouvernance des peuples autochtones à caractère pluriethnique et multiculturel (24), dont les populations de Varela pourraient très bien s’inspirer.
Les autorités de Guinée Bissau pourront toujours s’opposer à un tel statut. Mais elles ne peuvent pas empêcher la volonté du peuple souverain de s’exprimer collectivement et démocratiquement, au cours d’une assemblée générale populaire, sous la houlette des autorités traditionnelles. C’est le principe de l’autodétermination, inscrit dans le droit international, et cela, personne ne peut le lui retirer.
PS : les autorités gouvernementales, ainsi que les représentants de la compagnie GMG Internationnal, injoignables, n’ont pu exprimer leur point de vue. Elles peuvent toujours se manifester après la lecture de cet article et s’il y a lieu, j’en modifierai le contenu.
Extrait du blog de Francois Badaire