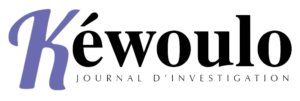Il est toujours hasardeux de dater précisément une vocation quand il s’agit d’écriture. La tentation de romancer à son avantage interférant, il nous est alors loisible, et on ne se prive pas, de compresser le temps, et de l’aliéner possiblement. Longtemps, je me suis refusé à toute exégèse de ce geste de naissance littéraire conscient que tout confesser, c’est épuiser un doux fumet mystérieux qui arrache l’irrationnel au domaine du seul divin et qu’il fallait se réapproprier. L’inexpliqué et son grand spectre offraient une échappatoire à la technicité par trop rationnelle du monde. Ce fut longtemps un catéchisme scrupuleusement suivi, une esthétique du contretemps. Je n’ai pas eu avant d’écrire – je n’en tire aucun motif de gloire – le loisir bourgeois de l’insouciance, de l’évasion, de l’échappée. Ni le plaisir aristocratique du snobisme cultureux. Encore moins le sas douillet des entrées en matières gouvernées par la délicatesse des rituels de mise à l’étrier. Les lettres ont été brulantes dès leur jaillissement, à vous en consumer l’âme. Vivre, écrire, a donc vite été une question d’urgence – et pour tout dire – de survie. J’ai commencé donc à écrire, accablé, désarmé, démuni, enveloppé dans un désespoir noir, le corps et l’esprit meurtris.
Le motif en était simple. A l’automne 2005, j’arrivai en France. Sur mon poste de télévision, seul compagnon d’exil, un soir de crachin malfaisant, le post-adolescent que j’étais vit sur l’écran des migrants clandestins arriver d’Afrique. C’était au journal télévisé de 20 heures. Sur une côte italienne quelconque, anonyme. Le ton du journaliste est crépusculaire, misérabiliste. Pourtant, aucun venin malveillant chez le bougre. La bande des secourus avançait à cloche-pied. A l’arrière du décor, un chalutier, un quai, le crépitement de quelques flashs, la rutilante croix des secouristes dans leurs combinaisons. Au milieu de la haie d’honneur fortuite qu’ils forment, les survivants de la mer. Une dizaine. Jeunes, sveltes, hommes, hagards, frissonnants, enveloppés dans des couvertures de survie qui ne portent que trop bien leur nom.
Dans le regard, qu’il fallait s’appliquer à voir et à lire, l’indicible blessure matinée d’espoir. Curieux mélange de tétanie furieuse et d’appétit de vie. Bouleversant contraste du tiraillement, de l’entrain, et de l’incertitude. Dans cette expression imprimée sur leurs visages, si précise qu’elle en est troublante, je vis plus que des symboles poignants : pour la première fois je vis des frères. L’écran se fit miroir. Jusqu’à la chétive constitution sahélienne qui nous unissait en passant par des rêves, l’évidence de notre fraternité d’âge, de conditions, d’histoire longue, m’apparut sans détour. La révélation fut vocationnelle à peu de choses près. L’emprunt immédiat à travers cette télévision de cette souffrance, dont je pris ma part, avec le généreux dévouement d’un humanisme retrouvé, fut, aussi loin que je me souvienne, la perte définitive d’une virginité de la conscience et l’entrée dans une gravité qui était la condition des miens. Le lendemain, je commettais un texte. Gauche, blasphématoire contre toute règles grammaticales, mais où germait, à petites doses, la compassion. Le titre du texte fut sobre : Convictions, publié dans un défunt blog. Parchemin qui voulait guérir l’Afrique.
L’empathie, je devais ainsi naître à son évidence. Sans sommation. Et ce n’était pas gagné. Pour beaucoup d’élus touchés par cette grâce du cœur, cela se transmet dans l’heureuse filiation des affections. Mais même quand on vous la transmet, elle n’est jamais un gage, elle demande un apprentissage et un éveil constants. Dans mon cas, les faveurs n’étaient pas si évidentes. Au Sénégal, voir un animal éventré susciter l’hilarité, un enfant supplicié s’inscrire dans la banalité du décor, la mutilation d’une femme célébrée comme l’acte de résistance de la tradition, entre autres sévices quotidiens, m’a longtemps tout rendu tolérable. Pleurer, c’était un acte de faiblesse. S’indigner, un caprice. Se rebeller, un aller simple vers la solitude.
Enfant, contraint au mimétisme des aînés, la souscription à ce code du désengagement se fait sans heurts. Le conservatisme des élites et la hiérarchie des références religieuses donnent l’onction ultime de l’inaction. Tel était le bain premier, il condamne à en garder les effluves sinon la sève constituante pour de longs pans de notre vie. Le silence en soi n’est pas crime. Celui véritable, c’est l’acceptation. Résignation sophistiquée que la tradition et ses tenanciers vendent comme élan de rupture. Cette vaste terre de la saignée ordinaire pouvait faire à l’enfance la tragique incorporation de l’évidence. La révolte étant un luxe rare face aux urgences de la survie, souscrire aux décrets ambiants était ainsi un négoce prospère pour la paix. La violence, c’était un langage admis, sa force anesthésiante finit par tout contaminer. La démographie galopante aidant, se constitue une armée de réserve, victime des morsures de la pauvreté, en lice pour la relève passive. Ainsi désailés par l’habitude, peu touchés par les affres de la violence grâce aux faveurs sociales qui affranchissent du malheur, moi et mes yeux nous faisions complices silencieux.
Tout cet assèchement de la fibre empathique dont nous fûmes tous dotés à la naissance, accompagnait les drames de la vie, jusque dans la mort. La mémoire des siens par-delà la mort, la gratitude qui en crée le socle, l’amour de ses défunts pour tisser le lien de la filiation et de la transmission, tout paraissait défectueux dans mon univers premier. La mort se terminait vite. Au mieux, le mémorial aux morts est profané par un silence, celui des stèles solitaires qui écrasent cet affect fondateur. On grandit dans la fatalité. Les décrets du divin étant inviolables et rabâchés à l’envi par tout prêche, à quoi bon par conséquent. Puisque le script est écrit. Ne reste plus qu’à slalomer entre les écueils, et souhaiter la baraka, en ne faisant point de vague. L’empathie pour les autres, c’était une affaire inaccessible.
Tout l’itinéraire de vie, les repères, de la famille aux fondement moraux et religieux, avalisent l’inaction et vident de son sens la notion de responsabilité. Cela condamne toute initiative de sécession à l’inefficience, à l’oubli face au monstre. Dans la compétition humaine et sa jungle, entendu qu’il n’y a pas de places, il faut y aller droit au but et ne pas s’accabler de ce sentiment qui exige de nous de nous arrêter malgré la frénésie du monde, d’infliger cette témérité insolente au temps. Longtemps, je pris part à la course, bon élève de cette sécheresse qui nous tarit le flot humaniste.
Pourtant, dans ce canapé, à Nice, malgré ce pédigrée pas des plus fameux, je m’étais senti une famille dans ces visages inconnus. J’avais certes commencé dès mes 13 ans une vaste entreprise de remise en cause des dogmes, codes, règles et morales de la société sénégalaise. Rien cependant d’urgent et de formel dans cet élan. A Nice, je voyais un conflit dont les contours à l’époque vaporeux tendaient à installer un malentendu originel sur la migration. Un conflit d’empathie. Entre le manque et le trop-plein, mais surtout entre le manque de la terre d’origine et les postures cyniques des accueillants. Depuis 2005, la scène inaugurale de ce sursaut, son motif, ont fait des petits. L’immigration clandestine fauche à rythme cadencé, et remplit la Méditerranée. Le temps n’est pas un allié. Il avance, et nous coulons. Dans l’indifférence gaillarde des à-coups.
Au moment où ce souvenir refait surface, les côtes européennes n’ont jamais été aussi prises d’assaut. Au Sénégal, près de 5000 départs ont été recensés en un seul mois. Le spectacle des cadavres flottants à quelques centaines de mètres des côtes de départs émeut, rapidement. Mais l’empathie, dans cette difficile épopée, se lasse. 77 % de notre jeunesse, la mienne, a envie de quitter le pays. C’est tout le patriotisme, tout le récit décolonial, toute la fierté nationale, tous les rêves de réussite locale, qui éclatent au sommet des escomptes, et les discours rageurs se cognent contre l’évidence de la désaffection.
J’ai consacré une thèse à cette migration, à la notion de la dette au pays, pour les comprendre. Je voudrais attribuer cette vanité à ce novembre de 2005. Par tous les moyens, l’écriture m’a semblé devoir être la perpétuelle recherche de la dignité humaine. J’ai poursuivi par un livre sur l’immigration, comme autant de petits meurtres de soi et entre soi, des meurtres admis. Ce jour primal sur les côtes italiennes, dans ce regard des secourus, et dans sa fuite, c’est elle, la dignité, qui était à la fois perdue mais à l’horizon. Nous étions les mêmes. Nous avions le même âge.
Qu’importe qu’ils prissent un frêle esquif et moi l’avion, qu’importe qu’ils fussent estampillés, « immigré » économique détestable et moi étudiant « choisi » donc béni, l’immigration me paraissait indivisible. Cette hiérarchie morale de l’acceptable à travers l’épicerie comptable de l’Occident trouvait confort dans nos représentations de reniement de nos frères. Le clash des classes sociales ressortait malgré le contournement (mal)habile du discours diasporique. La famille n’était pas unie, et cette sourde violence, entre la réalité de la condition et le désir de réalisation, était l’acide où macère la noblesse des sentiments qui en finissent contaminés, radioactifs. Elle fondait une entreprise de reconquête, dans cet espace ambivalent de la violence symbolique intégrée, dont le travers le plus difficile à éviter est le ressentiment.
De l’empathie, on en fait commerce à foison en Europe. Dans un outillage et des desseins si sophistiqués qu’on pourrait se laisser duper. L’Europe se barricade, dope les foyers identitaires, fait de la méditerranée son cimetière protecteur. Elle externalise sa frontière, s’acoquine avec des tyrans pour multiplier ses frontières extérieures, tantôt en Tunisie, tantôt en Turquie, jadis en Libye avec le fréquentable Kadhafi et son désert qui engloutissait avec appétit les africains. Ne pas devoir accueillir toute la misère du monde donne quitus à l’abrogation de sa souffrance. Dans le genre, la mort est une thérapie on ne peut plus efficace. L’illusion d’un hermétisme salvateur, que les chancelleries européennes entretiennent, s’accompagne des prétentions de grand seigneur : sauver l’Afrique, l’aider à se développer. Déversement de capitaux, blanchiment moral à grand frais.
Mais le forfait demeure. Pas une once d’empathie, d’humanité malgré la fiévreuse débauche de bons sentiments. Plus philosophiquement, dans un monde où les damnés de la terre ne veulent plus consentir à la subalternité de leur condition, il y a urgence à repenser un ordre plus juste, plus humain, sur l’égalité réelle des droits. J’ai toujours eu du mal à ce qu’on subordonne la vie d’un homme à des papiers, ses émotions, son rire, sa vie, mais voila un péril administratif admis de longue date. Et la Loi immigration en France vient allonger la funeste liste de la suspicion jetée sur l’étranger, agent surnuméraire et potentiellement parasitaire. L’empathie sauce affichage est un commerce législatif à perte. On y perd le fondement de la dignité humaine, sans laquelle rien de grand ne se construit.
Cet effort collectif ne peut être la charge de l’unique Occident, entendu qu’il n’est pas le seul centre du monde, d’où on énonce la fabrique des déséquilibres. L’Occident, s’il ne faut nullement le disculper, a souvent le dos large. Il se voit imputer des tares en réalité universelles, tant en la matière le reste du monde ne fait ni mieux ni plus prometteur, et ne propose comme alternative qu’une seule offre, celle de la réaction.
Par la même, il prétend capitaliser sur un rejet qui ne peut être à lui seul la fondation d’une alternative. Sur cette table de dissection du corps de l’empathie, la scène Niçoise de la télévision, sa récurrence, sa tragédie devenue si commune, m’ont toujours commandé d’aller à la racine. Les drames de l’immigration ne doivent pas uniquement hanter la conscience de l’Europe. Il nous appartient, pour ne pas être prisonniers de nos rancœurs folles, de faire de l’empathie l’obsession de nos vies. Le chemin sera long. Ce qu’il faudra pour la construire, c’est regrouper avec témérité chaque fragment de cette humanité rapiécée, pour faire renaitre une empathie authentique.
Des enfants laissés à eux-mêmes aux droits des femmes, en passant par le refus de s’enfermer dans les poisons identitaires du différentialisme, le grand inventaire des sujets à embrasser est large. Il suppose de fournir un effort capital, et ainsi redonner à la vie sa pleine valeur, en regardant le monde à hauteur d’humanité. Ni pour y faire de la figuration, ni pour y quémander la pitié.
Produire en somme de l’amour pour les nôtres et pour le monde, pour refaire de nos deuils l’humus de notre mémoire, l’élan de nos affections, et notre proposition du monde, pour une humanité intégrale. Dans nos grandes mégardes de lecture, on a qualifié l’immigration africaine de fuite de la misère : elle n’est pas tant économique qu’affective. Les candidats forcenés au départ, malgré les risque connus, mirages déconstruits depuis des décennies, recherchent la liberté, l’accomplissement, la renaissance. L’aveu d’un tel échec, en l’absence de discours sincères en lieu et place des analyses faciles et flattant la bonne conscience, est la promesse de la chair toujours offerte à l’océan. Une reconquête de l’empathie pourrait bien s’avérer une modeste mais si inestimable thérapie.