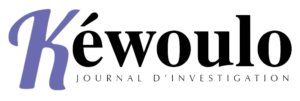Au Sénégal, l’heure est au bilan après les violentes émeutes des mois de février et mars. L’atmosphère politique demeure tendue alors que plusieurs manifestants arrêtés lors de ces mouvements de protestation, déclenchés suite à l’affaire judiciaire impliquant l’opposant Ousmane Sonko, affirment avoir été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre ou dans les lieux de privation de liberté.
S’il est difficile de cerner précisément l’ampleur du phénomène, les ONG de défense des droits humains s’inquiètent de ces témoignages qui nourrissent le ressentiment de la jeunesse vis-à-vis des autorités.
« Mes menottes étaient tellement serrées que le sang circulait mal. Puis on m’a frappé avec des chaînes de moto et on m’a donné des coups dans les testicules, tout en me posant des questions », rapporte ainsi Mohamed Ndoye, manifestant de 40 ans arrêté le 8 février et qui a passé quatre jours en garde à vue dans le commissariat central de Dakar.
« On m’accusait d’avoir jeté des pierres et brûlé des voitures », explique ce chauffeur et père de famille. Les violences se sont arrêtées, explique-t-il, quand un avocat, Me Babacar Ndiaye, est arrivé pour le défendre.
« Giflé puis frappé avec des bâtons »
Ce dernier a constaté des cicatrices sur le corps de son client, qui a dû arrêter de travailler. Des blessures similaires à celles qu’il a observées chez d’autres manifestants arrêtés le même jour à Dakar. Mohamed Ndoye et d’autres détenus arrêtés le même jour ont été libérés après la médiation menée début mars par un émissaire du khalife général des mourides, l’une des plus influentes confréries religieuses du pays.
Les forces de l’ordre de Dakar ne sont pas les seules visées par les accusations de mauvais traitements. A Diaobé, dans le sud du pays, Papis Sagna, 30 ans, a été arrêté dans la nuit du 7 au 8 mars avec vingt-six autres jeunes de cette petite ville où la brigade de gendarmerie a été incendiée.
Au téléphone, il raconte qu’ils ont été « torturés » d’abord par des gendarmes à Diaobé puis dans la commune voisine de Vélingara. « J’ai été giflé puis frappé avec des bâtons », explique l’étudiant membre du Pastef-Les Patriotes, le parti dirigé par Ousmane Sonko.
Libérés le lendemain après une nuit et une journée de détention, les vingt-sept jeunes ont dû rentrer chez eux à plus de 30 kilomètres. « Je ne pouvais pas marcher, j’avais mal aux jambes à cause des coups. Les gendarmes avaient gardé mon argent et mon téléphone », poursuit Papis Sagna.
La torture existe bel et bien
Depuis, un médecin a constaté que ses dents et ses yeux ont été abîmés. Des meurtrissures dont il a gardé la trace en photo dans l’espoir de porter plainte. « Ces gens doivent être punis pour ce qu’ils ont fait. Personne ne mérite un tel traitement », revendique Papis Sagna, qui est en contact avec Amnesty International.
Seydi Gassama, directeur exécutif de l’ONG au Sénégal, regrette qu’aucune enquête officielle n’ait été ouverte sur les violences commises à Diaobé. Car ces pratiques, selon lui, relèvent effectivement de la torture, d’après la définition qu’en fait la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée par le Sénégal.
« Les allégations de torture s’intensifient à chaque fois que des événements violents secouent le pays, comme en 2011-2012 lors des manifestations contre le troisième mandat de l’ancien président Abdoulaye Wade », rappelle le militant des droits humains.
Si elle n’est pas systématique, la torture existe bel et bien au Sénégal. Seydi Gassama est régulièrement interpellé sur des cas individuels à travers le pays. Même s’il note une amélioration de la situation depuis les années 1990, le militant s’inquiète du déni de l’Etat face à ces pratiques.
« Pas d’impunité si les faits sont établis »
Pour le moment, Amnesty a compté moins de dix condamnations depuis 2007 dans des dossiers où l’ONG dénonçait des cas de torture. Quand les affaires ne sont pas classées sans suite, les faits, regrette-t-il, ont toujours été minimisés et souvent requalifiés « d’homicide involontaire ». « L’Etat protège ses forces de défense et de sécurité », assure-t-il.
Ces accusations suscitent le malaise au sein du pouvoir. Pour calmer les esprits, le ministre des forces armées, Sidiki Kaba, a annoncé le 8 avril qu’une commission d’enquête libre et indépendante serait mise en place afin que « la lumière soit faite » sur les violences des mois de février-mars. Mais aucun calendrier n’a encore été précisé.
« Les forces de l’ordre ont fait preuve de professionnalisme et de retenue. N’eut été cela, nous aurions eu un bain de sang », a insisté le ministre, minimisant les accusations d’usage disproportionné de la force. « Je ne dirais pas qu’il n’y a pas eu d’acte qui peut s’assimiler à un acte de torture, mais on ne peut pas dire que c’est un système et un ordre donné par un gouvernement », a-t-il encore indiqué, tout en assurant qu’il n’y aurait « pas d’impunité si les faits sont établis ».
Dès le 21 février, la police nationale avait déjà réagi à ces allégations par voie de communiqué. « Toutes les actions menées lors de ces manifestations sont en parfaite conformité avec les lois et règlements en vigueur. (…) Ces supposés cas de torture n’ont été ni constatés par un médecin, encore moins attestés par une décision de justice », se défendaient les forces de l’ordre.
« Enquête administrative pénitentiaire »
L’annonce par les autorités de la constitution d’une commission d’enquête indépendante ne suffit pas à rassurer le directeur d’Amnesty International Sénégal, qui encourage les victimes présumées à porter plainte. Le Mouvement de défense de la démocratie (M2D), créé après l’arrestation de M. Sonko et comprenant son parti, des partis d’opposition et des organisations contestataires, travaille d’ailleurs à constituer un dossier pour la justice.
Mais « nous nous retrouvons face au défi d’apporter les preuves des violences subies, surtout quand les tortures sont morales », souligne Habib Sy, coordonnateur d’une commission judiciaire au sein du mouvement, chargée de la prise en charge des personnes blessées entre le 3 et le 8 mars.
Guy Marius Sagna, activiste du mouvement Frapp-France Dégage, affirme ainsi avoir été victime de « tortures psychologiques » lors de son arrestation fin février. Placé sous mandat de dépôt dans la maison d’arrêt de Cap Manuel à Dakar, il avait entamé une grève de la faim pour dénoncer des conditions de détention « inhumaines et dégradantes ».
« Nous étions entre 150 et 200 détenus entassés dans une chambre prévue pour 50 personnes. Nous n’avions qu’une seule toilette, nous ne pouvions pas dormir allongés et j’ai été fouillé intégralement nu », détaille-t-il. Son avocat, Me Moussa Sarr, souligne lui aussi la difficulté de fournir des preuves. « Seul l’Etat peut en apporter. Une enquête administrative pénitentiaire devrait être ouverte pour identifier les responsables, car nous n’avons pas accès à l’intérieur des prisons », explique-t-il.
Une équipe de l’Observateur des lieux de privation de liberté, institution étatique mise en place en 2012, a été dépêchée pour passer une journée dans la prison de Cap Manuel, puis elle a remis un rapport confidentiel aux autorités compétentes.
Cette organisation, rattachée au ministère de la justice, est chargée de visiter les commissariats, brigades de gendarmerie, prisons ou maisons d’arrêt afin d’apporter des recommandations pour améliorer les conditions en milieu carcéral et éradiquer la torture et les mauvais traitements.
« Même s’il y a encore des efforts à faire, notamment en termes de surpopulation, il y a des améliorations », assure Josette Marceline Lopez Ndiaye, la responsable de l’observatoire, qui s’était mobilisée pour stopper les violences à l’encontre des jeunes de Diaobé. « Mais un renforcement de notre budget et de notre indépendance reste une priorité pour plus d’efficacité dans notre travail », reconnaît-elle.