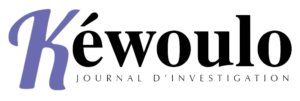Entre murs et barrières, les familles des détenus comme celles des malades partagent le même exil intérieur. Le silence, l’attente, le manque de considération. Aux portes des prisons comme dans les cours d’hôpitaux, les matinées se ressemblent. À l’aube, des silhouettes se dessinent dans la pénombre, serrées les unes contre les autres, un sac à la main, une lueur d’espoir dans le regard. Les files s’allongent lentement, marquées par la fatigue et l’incertitude.
Sous un soleil brûlant ou une pluie battante, des femmes patientent, des mères, des épouses, dans la plupart des cas, les bras chargés de repas, d’un nécessaire de toilette, de linge propre, d’un petit stock de lait, de café, de fruits. Rien n’est certain. Ni le moment de l’entrée, ni même la possibilité de voir celui ou celle qu’elles viennent visiter.
À l’hôpital, la scène se répète sous d’autres formes. Des bancs étroits, des couloirs glacials, des regards perdus. On attend l’autorisation, le médecin, un mot. On attend de savoir si le malade respire encore. L’attente, ici, est une douleur en soi, une brûlure lente que rien n’apaise. La douleur ne se mesure plus à la maladie ou à la blessure, mais à l’ignorance, au manque de nouvelles, à l’impossibilité d’agir. C’est la douleur muette de ceux qui vivent aux marges des institutions, entre espoir et désespoir, entre amour et impuissance.
Dans les prisons, chaque visite est une épreuve. Il faut d’abord passer les portails, présenter des papiers, attendre qu’un nom soit appelé. Les règles varient selon les jours ou selon les humeurs. Personne ne les explique. On s’y soumet.
Dans les hôpitaux, c’est une autre forme de parcours du combattant. Il faut obtenir un ticket, trouver un médecin, déchiffrer une ordonnance, chercher la bonne porte. Partout, l’attente s’impose comme une discipline tacite, un apprentissage forcé de la résignation.
Le silence administratif pèse plus lourd que des portes fermées à clé. Les guichets restent muets, les agents sont débordés, et les proches se perdent dans un dédale de consignes contradictoires. L’administration devient un mur. Il faut frapper longtemps avant qu’une voix ne réponde.
Peu à peu, les visiteurs apprennent à étouffer leur colère, à contenir leurs larmes, à se plier aux lenteurs d’un système où la compassion semble inaccessible. Ils finissent par accepter l’inacceptable : que le temps de la douleur ne soit pas pris en compte.
Entre le détenu et son visiteur, entre le malade et son accompagnant, la frontière s’estompe. Tous semblent prisonniers du même système. Les proches subissent les mêmes humiliations. Questions intrusives, remarques déplacées, ordres brusques.
Dans les hôpitaux, la violence est plus discrète, mais surtout destructrice regards froids, gestes brusques, absence de considération. On s’adresse à la maladie, rarement à la personne. Les familles, par crainte d’aggraver le sort de leur malade, se taisent, et encaissent.
La dignité s’effrite peu à peu, dans de petits riens. Un document tendu sans un regard, une question restée sans réponse, un refus exprimé sèchement. On apprend à disparaître pour ne pas déranger, à marcher sur la pointe des pieds dans les couloirs où règnent peur et l’impuissance.
Et pourtant, ces familles ne demandent rien d’extraordinaire. Seulement qu’on leur explique, qu’on les écoute, qu’on leur accorde un peu de respect au milieu de la tempête.
Il serait trop facile cependant d’imputer la faute aux agents. Les prisons sont surchargées, les hôpitaux ploient sous la charge, les effectifs sont rares, les ressources n’arrivent qu’après des mouvements de grève. Les gardiens, les infirmiers, les aides-soignants travaillent souvent dans des conditions difficiles et parfois, indignes, eux aussi prisonniers d’un système usé.
Des cellules conçues pour vingt, accueillent parfois cent détenus, entassés dans une promiscuité insoutenable. Le sommeil se fait à tour de rôle. Dans les hôpitaux, le manque de lits engendre les mêmes scènes d’étouffement Il n’est pas rare de voir des malades allongés sur des brancards dans les couloirs. Les files s’allongent à chaque visite, les corps s’épuisent avant même d’être soignés ou écoutés. La surpopulation carcérale et l’engorgement hospitalier font des couloirs, de véritables lieux de survie, des zones d’attente sans fin où l’espoir se tend comme une corde trop fragile. Les familles, les proches, acculées, voient défiler les heures et les gardiens, les jours et les médecins, sans jamais être sûres d’atteindre le moment de la rencontre.
La responsabilité de l’État reste entière. Car l’humanité ne dépend pas du budget elle dépend du regard posé sur autrui L’Etat s’abrite trop souvent derrière des difficultés ou des complexités financières pour dissimuler son indifférence. Or, la compassion n’est pas un supplément. C’est une exigence morale au cœur même du service public. Et pour les gardiens ou le personnel soignant, expliquer, orienter, rassurer, offrir un mot d’accueil ou un sourire : ces gestes simples ne coûtent rien, mais ils changent tout.
Et pourtant, malgré tout, ces visiteurs, ces accompagnants, reviennent.
Chaque semaine, parfois chaque jour, ils reprennent la route vers la prison ou vers l’hôpital, sans garantie, mais avec une détermination tenace. Ils tissent entre eux une fraternité invisible. Dans les files, on échange, on se reconnaît, on partage des nouvelles et du courage. Dans ces lieux d’attente, nait une forme de solidarité qui ne fait pas de bruit, mais qui aide à maintenir debout, ceux que la douleur aurait pu briser.
Ce sont les visages qu’aucune caméra ne capte, des voix qu’aucun micro n’enregistre. Ce sont des veilleurs de l’ombre. Ils rappellent qu’il existe une autre forme de justice, une autre médecine qui est celle du lien, et de la présence.
Parfois, une infirmière s’arrête un instant, un gardien adoucit le ton de sa voix, un médecin prend le temps d’expliquer. Et c’est peut-être cela, la plus grande victoire de ceux qui attendent : ne pas laisser le système les déshumaniser à leur tour.
Une fois rentrés à la maison, il y a une douleur plus sourde qui s’installe. La détention d’un fils ou d’un époux, la maladie d’un père ou l’agonie d’une mère hospitalisée, creusent dans les foyers un vide qu’aucune parole ne peut combler. La maison devient alors, elle aussi à son tour, une salle d’attente. Les repas se prennent en silence, s’ils sont pris, le lit conjugal devient trop grand, un coin de la maison reste vide. Le téléphone devient à la fois espoir et menace. Un appel peut tout changer ou bien briser ce qui reste d’équilibre. Quand un proche est en prison, on ne porte pas le noir, mais le cœur se couvre de la même poussière que celle des murs où il survit. On ne pleure pas un mort, mais on endure une disparition suspendue, sans date ni sépulture. Chaque nuit, la pensée s’envole de l’autre côté du mur. Comment va-t-il passer cette nuit ? Tient-il encore ? L’inquiétude devient une compagne obstinée, plus fidèle que l’espoir. Le jour, on fait semblant de vivre. Le soir, on écoute le silence. Peu à peu, un trou use les corps et fragilise les âmes. Certains tombent malades, à leur tour, rongés par l’impuissance. D’autres perdent leur emploi, leurs amis ou le goût de vivre. La terre continue de tourner, mais eux restent figés dans le temps suspendu de l’attente. C’est une chaine silencieuse de souffrances. La prison déborde dans le foyer et l’hôpital s’installe dans les esprits.
Entre la prion et l’hôpital, il n’y a qu’un pas. Celui de la souffrance commune. Celle des vivants oubliés. Les visiteurs, les accompagnants restent les invisibles d’un système débordé par les procédures et dépourvu de compassion.
Dans un pays qui se veut fondé sur la solidarité et la justice, la façon dont on traite ceux qui attendent, révèle notre humanité collective. Car il ne suffit pas seulement de soigner les malades ou de sanctionner les fautes. Il faut aussi respecter. Il faut aussi respecter ceux qui continuent encore d’aimer envers et contre tout. Ces familles vivent enfermées dans une douleur sans mur, mais prisonnières d’un système qui oublie qu’elles méritent, elles aussi, soin et considération. Elles rappellent que la détention ou la maladie ne touchent jamais qu’une seule personne, mais un cercle d’affection.
Peut-être qu’un jour, dans les couloirs, on commencera par leur dire : « Bon asseyez-vous, on va vous expliquer ». Ce serait déjà une révolution. Celle du respect, de la parole et du lien retrouvé.















![[Billet d’humour] Le Maroc réussit sa panenka… carcérale !](https://i0.wp.com/kewoulo.info/wp-content/uploads/2026/02/suporter-senegal.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)