Les opérations commencent avec la guerre contre les Talibans, en application de la doctrine Cheney après la rupture des négociations pour construire un pipeline à travers l’Afghanistan, à la mi-juillet 2001. L’ambassadeur Niaz Naik, qui représentait le Pakistan aux négociations de Berlin avec les Talibans, était revenu à Islamabad en considérant l’attaque US inévitable. Son pays avait commencé à se préparer à ses conséquences. La flotte britannique s’était déployée en mer d’Oman, l’OTAN avait acheminé 40 000 hommes en Égypte, et le leader tadjik Ahmed Shah Massoud avait été assassiné deux jours avant les attentats de New York et de Washington.
Les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni à l’ONU, John Negroponte et Sir Jeremy Greenstock, assurent que le Président George W. Bush et le Premier ministre Tony Blair appliquent le droit à la légitime défense en attaquant l’Afghanistan. Or, toutes les chancelleries savent que Washington et Londres voulaient faire cette guerre indépendamment des attentats. Au mieux, elles concluent qu’ils instrumentent le crime dont seul le premier a été victime. Cependant je parviens à jeter le doute mondialement sur ce qui s’est vraiment passé ce 11-Septembre. En France, le Président Jacques Chirac fait évaluer mon travail par la DGSE. Après une vaste enquête, celle-ci constate que tous les éléments sur lesquels je m’appuie sont véridiques, mais elle ne peut pour autant confirmer mes conclusions.
Le quotidien Le Monde, qui a ouvert une campagne pour me discréditer, brocarde mes prévisions selon lesquelles les États-Unis vont attaquer l’Irak. Pourtant, l’inévitable se produit. Washington accuse Bagdad d’héberger des membres d’Al-Qaïda et de préparer des armes de destruction massive pour attaquer le « pays de la liberté ». Ce sera donc bien la guerre, comme en 1991.
Chacun est alors face à un cas de conscience. En persistant à fermer les yeux sur le coup d’État du 11-Septembre, on s’interdit de contester le discours des États-Unis et l’on se trouve contraint d’approuver le crime suivant : l’invasion de l’Irak en l’occurrence. Seul, un haut fonctionnaire international, Hans Blix, décide de défendre la vérité. Ce diplomate suédois est l’ancien directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il préside la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies, chargée de surveiller l’Irak. Tenant tête à Washington, il affirme que l’Irak n’a pas les moyens dont on l’accuse. Une pression sans précédent pèse bientôt sur ses épaules : non seulement l’Empire états-unien, mais tous ses alliés font pression sur lui pour qu’il cesse ses enfantillages et laisse la première puissance du monde détruire l’Irak. Il ne cédera pas, même lorsque son successeur à l’AIEA, l’Égyptien Mohamed el-Baradei, feindra de jouer les conciliateurs.
Le 5 février 2003, le secrétaire d’État et ancien chef d’état-major interarmées Colin Powell prononce un discours au Conseil de sécurité, dont le texte a été rédigé par l’équipe de Cheney. Il accuse l’Irak de tous les maux, y compris de protéger les auteurs des attentats du 11-Septembre et de préparer des armes de destruction massive pour attaquer les États occidentaux. Au passage, il révèle l’existence d’un nouveau visage d’Al-Qaïda, Abou Moussab Al-Zarqaoui.
Mais, à son tour, Jacques Chirac refuse de se joindre au crime. Il ne s’imagine pas pour autant dénoncer les mensonges de Washington. Il envoie son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, au Conseil de sécurité. Celui-ci laisse à Paris les rapports de la DGSE et concentre son intervention sur la différence entre une guerre imposée et une guerre choisie. Il est clair que l’attaque de l’Irak n’a aucun rapport avec le 11-Septembre, mais est un choix impérial, une conquête. Villepin va alors souligner les résultats déjà obtenus par Blix en Irak. Puis il va dégonfler les accusations US pour montrer que l’usage de la force ne se justifie pas à ce stade et conclure que rien ne prouve que la guerre puisse obtenir de meilleurs résultats que la poursuite des inspections. Croyant que cette intervention va offrir une porte de sortie à Washington et que la guerre sera évitée, le Conseil de sécurité l’applaudit. C’est la première fois que des diplomates applaudissent l’un des leurs dans cette salle.
Non seulement Washington et Londres imposeront leur guerre, mais oubliant Hans Blix, les États-Unis vont entreprendre toutes sortes d’opérations pour « faire payer » Chirac. Le Président français ne tardera pas à baisser sa garde et à servir plus que de nécessaire son suzerain états-unien.
Nous devons tirer les leçons de cette crise. Hans Blix, comme son compatriote Raoul Wallenberg durant la Seconde Guerre mondiale, a refusé l’idée que les États-uniens (ou les Allemands) soient supérieurs aux autres. Il a décidé de tenter de sauver des hommes qui n’avaient commis d’autres crimes que d’être Irakiens (ou juifs hongrois). Jacques Chirac aurait voulu être comme eux, mais ses erreurs précédentes et les secrets de sa vie privée l’ont exposé à un chantage qui ne lui a laissé que le choix de se démettre ou de se soumettre.
Washington prévoit de placer au pouvoir à Bagdad des Irakiens en exil qu’il a sélectionnés au sein d’une association britannique, le Conseil national irakien, présidé par Ahmed Chalabi. Que celui-ci soit par ailleurs considéré comme un escroc international après sa condamnation dans la faillite de la Banque Petra de Jordanie n’est pas pris en compte. L’avionneur Lockheed Martin créé un Comité pour la libération de l’Irak, dont l’ancien secrétaire d’État et mentor de Bush Jr, George Shultz, prend la présidence. Ce Comité et le Conseil de Chalabi vendent cette guerre à l’opinion publique états-unienne. Ils assurent que les États-Unis se borneront à prêter assistance à l’opposition irakienne et que ce ne sera pas long.
Comme l’attaque de l’Afghanistan, celle de l’Irak a été préparée avant les attentats de New York et de Washington. Le Vice-président Dick Cheney avait lui-même négocié au début 2001 l’implantation de bases militaires US au Kirghizstan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan dans le cadre du développement des accords Central Asia Battalion (CENTRASBAT) de la Communauté économique d’Asie centrale. Les planificateurs ayant anticipé que pour faire cette guerre, les troupes nécessiteraient 60 000 tonnes de matériel par jour, le Centre de gestion des transports militaires (Military Traffic Management Command – MTMC) avait été chargé de commencer à l’avance à y transporter la logistique.
L’entraînement des troupes n’a eu lieu, lui, qu’après les attentats. Ce furent les plus importantes manœuvres militaires de l’Histoire : « Défi du Millénaire 2002 » (Millennium Challenge 2002). Ce jeu de guerre mêlait des manœuvres réelles et des simulations en salle d’état-major réalisées grâce aux outils technologiques utilisés à Hollywood pour le film Gladiator. Du 24 juillet au 15 août 2002, 13 500 hommes ont été mobilisés. Les îles de San Nicola et San Clemente, au large de la Californie, et le désert du Nevada avaient été évacués pour servir de théâtre d’opérations. Cette débauche de moyens nécessita un budget de 235 millions de dollars. Pour la petite histoire, les soldats simulant les troupes irakiennes étaient commandés par le général Paul Van Riper ; mettant en œuvre une stratégie non conventionnelle, ils l’emportèrent haut la main sur les troupes états-uniennes de sorte que l’état-major cessa l’exercice avant sa fin.
Ne tenant compte ni des rapports de Hans Blix, ni des objections françaises, Washington lance l’« Opération Libération de l’Irak » (Operation Iraqi Liberation), le 19 mars 2003. Compte tenu du sens que revêt son acronyme anglais, OIL (pétrole), elle est renommée « Opération Liberté irakienne » (Operation Iraqi Freedom). Un feu d’une puissance inégalée s’abat sur Bagdad, causant le « choc et la stupeur » (Shock and Awe). Les Bagdadis sont hébétés, tandis que les États-Unis et leurs alliés s’emparent du pays.
Le gouvernement est d’abord assumé par un bureau du Pentagone, l’ORHA (Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance), puis au bout d’un mois par un administrateur civil nommé par le secrétaire à la Défense, L. Paul Bremer III, l’adjoint dans le privé d’Henry Kissinger. Il prend bientôt le titre d’administrateur de l’Autorité provisoire de la Coalition. Or, contrairement à ce que cette dénomination laisse supposer, cette Autorité n’a pas été créée par la Coalition qui ne s’est jamais réunie et dont on ignore exactement la composition.
Pour la première fois, un organe apparaît qui dépend du Pentagone, mais ne figure sur aucun organigramme des États-Unis. Il est l’émanation du groupe qui a pris le pouvoir le 11 septembre 2001. Dans les documents publiés par Washington, l’Autorité est désignée comme un organe de la Coalition si le document est destiné à des étrangers, et comme un organe du gouvernement US s’il est destiné au Congrès. À l’exception d’un fonctionnaire britannique, tous les employés de l’Autorité sont payés par des administrations états-uniennes, mais ne sont pas soumis aux lois US. Aussi prennent-ils leurs aises par rapport au Code des marchés publics. L’Autorité saisit le Trésor irakien, soit 5 milliards de dollars, mais seul un milliard apparaît dans sa comptabilité. Que sont devenus les 4 milliards restants ? La question est posée à la conférence de Madrid pour la reconstruction. Elle ne recevra jamais de réponse.
L’adjoint de Paul Bremer n’est autre que Sir Jeremy Greenstock, le représentant du Royaume-Uni au Conseil de sécurité qui a justifié les attaques de l’Afghanistan et de l’Irak. Durant l’occupation, les États-Unis examinent les possibilités de remodelage de l’Irak, en l’occurrence de la partition en trois États, selon le plan du sénateur démocrate Joe Biden. Bremer envoie donc l’ambassadeur Peter Galbraith – qui a organisé la partition de la Yougoslavie en sept États distincts – comme conseiller du Gouvernement régional kurde.
Bremer travaille directement avec le secrétaire adjoint à la Défense, Paul Wolfowitz, qui a défini la stratégie US future lors de la dissolution de l’URSS. C’est un juif trotskiste qui a été formé à la pensée de Leo Strauss. Il a installé au Pentagone de nombreux adeptes du philosophe allemand. Ils forment ensemble un groupe structuré, très cohérent et solidaire. Selon eux, tirant la leçon de la faiblesse de la République de Weimar face aux nazis, les juifs ne peuvent pas avoir confiance en des démocraties pour les prémunir face à un nouveau génocide. Ils doivent au contraire prendre le parti des régimes autoritaires et se placer du côté du pouvoir. Ainsi, l’idée d’une dictature mondiale est légitimée de manière préventive.
Wolfowitz fixe les grandes lignes du travail de l’Autorité provisoire de la Coalition, à savoir la débaasification du pays – c’est-à-dire le limogeage de tous les fonctionnaires membres du parti laïc Baas – et son pillage économique. Sur ses instructions, Bremer attribue tous les contrats publics à des sociétés amies, généralement sans appels d’offres ; ce qui exclut par principe les Français et les Allemands coupables de s’être opposés à cette guerre impériale.
La totalité des membres du Projet pour un nouveau siècle américain, le think tank qui a préparé le 11-Septembre, est incorporée, directement ou indirectement, dans l’Autorité provisoire de la Coalition ou travaille avec elle.
Dès le début, ces gens soulèvent une vive réticence. D’abord celle du représentant du secrétaire général de l’ONU, le Brésilien Sérgio Vieira de Mello. Il est assassiné le 19 août 2003, prétendument par le jihadiste Abou Moussab Al-Zarqaoui que Powell avait dénoncé à l’ONU. Les proches du diplomate soulignent au contraire le conflit qui l’opposait à Wolfowitz et accusent directement une faction états-unienne. Puis, c’est le général James Mattis, commandant de la 1re division des Marines, qui s’inquiète des conséquences désastreuses de la débaasification. Il finira par rentrer dans le rang.
Emportés par leurs succès aux États-Unis, en Afghanistan et en Irak, les hommes du 11-Septembre orientent leur pays vers de nouvelles cibles.
Par Thierry Meyssan, VOLTAIRENET.ORG.














![[Billet d’humour] Le Maroc réussit sa panenka… carcérale !](https://i0.wp.com/kewoulo.info/wp-content/uploads/2026/02/suporter-senegal.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)






















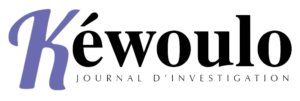

















Libye, Afghanistan, Mali…: comment les « Gendarmes du monde » ont semé le chaos et promu l’insécurité
https://www.senenews.com/actualites/libye-afghanistan-mali-comment-les-gendarmes-du-monde-ont-seme-le-chaos-et-promu-linsecurite_362664.html
MALI-AFGHANISTAN: La doctrine américaine et l’agenda français. Par Babacar Justin Ndiaye
https://www.pressafrik.com/MALI-AFGHANISTAN-La-doctrine-americaine-et-l-agenda-francais-Par-Babacar-Justin-Ndiaye_a236545.html