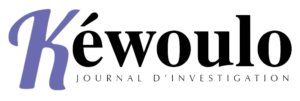Leurs vies ont basculé à la faveur d’une sentence, entraînant du coup une déchéance totale. Incursion dans le quotidien des condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Enquête exclusive !
Entre déni et espoir. Longtemps, il a attendu une oreille attentive. Longtemps, elle s’est fait désirer. Et pourtant, Bocar* a toujours tenu bon. Plus par souci de préserver sa vieille mère, usée par les allers et retours qu’autre chose. «Si ce n’était pas le soutien de ma mère, je pense que j’aurais cessé de me battre et je me serais laissé mourir, puisque ma vie ne vaut plus la peine d’être vécue.» Bocar est un des 77 (67 au Camp pénal, 9 à Koutal et 1 femme à Rufisque) détenus condamnés aux travaux forcés à perpétuité au Sénégal.
A 33 ans, le jeune homme, père de deux enfants, a vu sa vie basculer dans un gouffre sans fin, pour le crime d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violence et usage d’arme. Une sentence qui s’est abattue sur sa tête comme un couperet ce jour de l’année 2017. Dans son caftan noir en popeline, barbichette taillée avec soin, des sandales aux pieds, l’homme, qui se dit mouillé dans une affaire dont il ignore les tenants et les aboutissants, n’a pas réussi à convaincre les juges de son innocence. Depuis, son monde a basculé. Voix rauque, petits yeux futés lançant un regard fuyant dans cette pièce confinée qui sert de local au chef de cour du camp pénal de Liberté 6, Bocar surjoue le rôle de la victime dans un mélodrame aux allures de plaidoirie. Il dit, la main droite sur la gauche : «On m’a mouillé à tort et le jour du procès, la partie civile a bien dit à la barre qu’il ne me reconnaissait pas parmi la bande qui l’a agressé. J’ai beau nier, j’ai quand même été condamné à la prison…à vie.»
Une condamnation qui a entraîné la dislocation de sa famille. Sa femme le quitte, son grand frère, qui s’était saigné pour le sortir du pétrin, a trépassé à l’annonce du verdict, ses amis lui tournent le dos. Durant cette chute abyssale, seules sa mère et ses sœurs restent son pilier. Stoïque, Bocar flanche pourtant la première nuit. Dans l’obscurité de sa cellule, le vernis se fissure au fur et à mesure que la nuit tombe. A l’extinction des lumières, blotti dans son matelas, le nez plongé dans la couverture qui lui sert d’oreiller, Bocar réalise la lourdeur de la sentence. Une boule d’angoisse prend forme au fond de sa gorge. Il suffoque, étouffe un sanglot et manque de péter un câble. Le regard plongé dans le blanc de l’œil de son interlocuteur, le jeune carreleur confie, le souffle court : «Ma première nuit après la condamnation a été horrible. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit.
Quand j’ai réalisé que j’étais condamné à passer le restant de ma vie en prison, j’ai craqué. Je peux même dire que j’ai frôlé la folie. Je ne mangeais plus, je ne m’habillais plus, ne prenais plus de douche. J’étais presque fou. J’entrais pieds nus dans les toilettes et mes habits étaient couverts de poux. N’eût été ma famille, j’aurais commis l’irréparable». Ce n’est pas faute d’avoir essayé. A Reubeuss où il a passé 7 ans de détention préventive, Bocar a tenté une fois de mettre fin à ses jours en buvant un mélange de grésil et d’eau de javel. Il a été sauvé in extremis. Aujourd’hui au camp pénal où il vient à peine d’entamer sa peine à perpétuité, Bocar s’échine à marcher sur le droit chemin pour espérer bénéficier dans quelques années d’une remise de peine et peut-être, d’une libération conditionnelle. Cela, en dépit de l’attente d’un jugement en appel qui tarde à se matérialiser.
Mais n’empêche, Bocar y croit. En attendant, le chef de chambre joue la courroie de transmission entre les autres détenus et le monde extérieur. Une sorte d’échappatoire qui lui permet de s’oublier et de s’amender. Mais surtout d‘apprivoiser la lourdeur de sa sanction. Il dit : «La prison à perpétuité est une sanction très lourde psychologiquement et mentalement. La perpétuité dessert plus qu’elle ne sert.
C’est pour cela que je fais mon maximum pour avoir une bonne conduite afin de bénéficier d’une remise de peine. Et cela est très difficile car certains détenus font leur maximum pour te chercher des noises mais je les évite et je fais attention à ne pas m’attirer d’ennuis car cela retarderait ma sortie», confie celui qui dit s’être amendé. Avant de plaider pour un allègement de cette peine coercitive. «Dix ans de prison suffisent pour qu’un homme s’amende. La perpétuité, cela change un homme et une vie.»
«Papa, quand est-ce que tu reviens ?». Cela transforme surtout un homme en un monstre froid. Comme Soriba*, une montagne de muscles et de glace, qui rit plus de sa peine qu’il n’en pleure. Armé de sa confiance, le jeune homme de 34 ans, papa d’un garçon de 10 ans, s’adosse au mur de sa résignation pour ne pas être ébranlé face à l’épreuve. Rire cynique, regard narquois, casquette vissée à l’envers sur un casque de cheveux coupés à ras, Soriba a écopé de la perpétuité pour le crime d’association de malfaiteurs, de meurtre avec barbarie et torture, de vol en réunion, de détention d’armes et d’usage de chanvre indien.
Son cauchemar a débuté en 2012. Alors qu’il coulait une journée de labeur ordinaire dans son garage dans la banlieue de Dakar, le mécanicien a été interpellé par les gendarmes. Motif ? Soriba est accusé d’avoir participé à un viol suivi d’un meurtre. Le pied gauche battant la mesure sur le sol carrelé du bureau du chef de cour de la prison, il explique : «Je suis ici à cause d’un téléphone volé. Ce téléphone contenait une puce qui a appelé le numéro d’une femme qui a été violée puis tuée. C’est ainsi que je me suis retrouvé au cœur de cette nébuleuse dont je ne comprends rien du tout.» Jugé en 2016, Soriba et sa bande écopent de la peine des travaux forcés à perpétuité. Mais lui, reste zen et affiche un flegme à toute épreuve.
Il lâche un rire sardonique, remonte le bras de son sweet-shirt et embraie : «A l’énoncé de la sentence, je suis resté digne. Je n’ai pas été ébranlé, parce que je suis quitte avec ma conscience. Je me suis dit que c’était une épreuve et il fallait que je la traverse.» Un semblant de moral d’acier qui s’effrite quand le manteau de la nuit enveloppe la prison. Enfermé dans le silence de sa conscience, il est gagné par le désarroi. L’aîné d’une fratrie de 4 prend soudainement conscience de la gravité de sa situation.
«Seul, j’ai commencé à mesurer la lourdeur de la peine qui s’était abattue sur moi. J’étais déboussolé. J’ai pensé au tort que je causais à ma famille, à ma mère surtout. J’étais soutien de famille et aujourd’hui, elle se retrouve sans ressources. Mon fils de 10 ans ignore tout de ma situation. Il vit avec sa mère et croit toujours que je suis en voyage. A chaque fois que je lui parle au téléphone, sa première question est : «Papa, quand est-ce que tu reviens ?». Là, je ne me retiens plus et je craque. La situation est très douloureuse.»
Il se tait, fixe le sol pendant quelques minutes, redresse la visière de sa casquette et lâche un rire nerveux. «Plus que la peine, le regard et les commentaires des voisins sont plus difficiles à supporter. Je suis affligé quand je songe à ma mère. Ce qu’elle vit est intolérable. Elle a dépensé toutes ses économies en honoraires pour les avocats.
Si cela ne tenait qu’à moi, elle ne se déplacerait plus pour venir me voir en prison, parce qu’après chacune de ses visites, j’ai le moral dans les talons.» Aujourd’hui, le jeune Soriba essaie de se refaire en continuant son métier de mécano au sein de la prison, mais surtout en ayant une conduite irréprochable afin de bénéficier d’une commutation de peine et d’offrir à sa mère le plus cadeau de sa vie : une belle-fille.
La perpétuité pour les épouses aussi
«C’est la pire des souffrances. Celle de savoir qu’on fait souffrir ceux qu’on aime», dit Omar* en plongeant son visage dans l’écharpe blanc qui lui entoure le cou. Gars solide aux mains géantes, Omar a une sensibilité à fleur de peau. Un rien lui fait monter les larmes aux yeux. Le souvenir de sa vie d’avant, l’évocation de son procès, le déroulement de ses journées…
A Koutal à quelques kilomètres de Kaolack où il purge sa peine de perpétuité depuis 2006 pour des faits de vol en réunion avec violence et détention illégale d’armes, Omar joue les maçons en attendant de reprendre son véritable métier de berger. «A part les samedis et les dimanches, il n’y a pas un jour où je ne désespère de sortir», répète-t-il tout le long de l’entretien.
C’est une sorte de mantra qui lui permet de chasser les larmes et surtout de s’attirer les faveurs du destin face à la souffrance des siens. Spécialement de sa mère et de sa femme qui continuent les visites à la prison contre vents et marées. Surtout contre son avis. Omar ne veut pas avoir leur souffrance sur la conscience. Il a déjà assez à faire avec la mort de son père lors de son incarcération.
«Mon père est mort … De chagrin», avoue-t-il, en butant sur le mot. Il lui faudra une interruption de 15 minutes et un verre d’eau pour se remettre de cet aveu. A la base, le prisonnier avait deux femmes. La seconde a trouvé le courage de s’en aller au lendemain de la sentence. Il en parle sans amertume ni rancune. «Elle a fait ses bagages, a prétexté une visite chez ses parents et n’est jamais revenue. Elle est jeune, juste la petite trentaine». La première, elle, a préféré s’emmurer avec son mari. Dans la prison des responsabilités familiales. Elle a en charge les enfants et sa belle-mère, devenue très vieille.
Omar, qui ne tarit pas d’éloges sur elle, a préféré hypothéquer sa défense au tribunal plutôt que de vendre le bétail pour se payer un avocat. La seule bonne décision qu’il dit avoir prise dans ce cycle infernal. Aider sa femme à subvenir aux besoins de la famille est d’ailleurs devenu son moteur dans la détention.
A Koutal, Omar, qui attend toujours de passer en appel, s’est construit une solide réputation de prisonnier modèle. L’administration pénitentiaire, dans sa mission de réinsertion, lui confie de petits travaux. Ce jour-là, il travaille sur un bâtiment en construction dans la prison pour lequel il recevra une indemnisation. «Comme toujours, j’en mettrai de côté pour donner à ma femme», dit-il, en essuyant les larmes qui coulent de ses yeux rougis par la culpabilité.
La femme de Souleymane,* elle, n’a pas cette chance. Malgré son âge très avancé, elle continuera à travailler la terre pour nourrir ses 11 enfants et son mari. Souleymane n’a personne dans la vie à part elle. Et elle n’a rien à part une portion de terre arable. «Ma femme est fatiguée, j’ai pitié d’elle et cela me fait mal de penser à la peine que je lui fais. Elle m’a appelé la dernière fois pour me dire combien elle était fatiguée… (Il est interrompu par un sanglot). Et pourtant, elle continue de m’envoyer un peu du produit de ses récoltes. Si un jour j’ai de quoi lui rembourser son bienfait…».
Emprisonné depuis 2011 pour empoisonnement, Souleymane est un pauvre hère qui «survit, le temps de mourir». Ses journées en prison sont rythmées par les applaudissements des gardes pénitentiaires. Une série d’applaudissements pour signaler la sortie dans la cour. Une autre pour mettre fin aux visites. Une dernière fois pour rentrer en cellule la nuit. Mais cela fait longtemps que les applaudissements des visites ne le concernent plus. Depuis la dernière fois que sa femme est venue lui présenter son dernier né à la prison du Camp pénal de Dakar où il attendait son appel.
«C’était le jour le plus difficile de ma vie. Ma femme a fait des kilomètres pour que je puisse voir le dernier né. Alors que j’allais le serrer dans mes bras, les gardes ont signalé la fin des visites et ne m’ont pas autorisé à tenir mon fils dans mes bras. J’ai regardé ma femme, j’ai vu le désespoir dans ses yeux et je ne cesse depuis de la bénir dans mes prières». C’est le seul moyen qu’a trouvé Souleymane pour témoigner sa reconnaissance à sa femme. Et peut-être aussi pour la maintenir dans cette prison à ciel ouvert qu’est devenue sa vie.
La seconde femme a préféré prendre son destin en main devant la situation de précarité et de pauvreté où est plongée la famille depuis la détention du mari. Lequel rejette son amertume sur sa première, coupable de l’avoir forcé à prendre une seconde épouse pour l’aider dans les tâches ménagères. Chez Souleymane, l’égocentrisme n’est jamais loin. Dans sa manière de se victimiser dans le crime qui lui est reproché. Dans ses intonations lorsqu’il évoque sa solitude en prison. Dans son acceptation de recevoir le fruit des récoltes d’une femme marginalisée et appauvrie par la condamnation de son mari.
Si la société parvient encore à accepter la fidélité d’une femme par rapport à un mari condamné. Elle n’est pas aussi conciliante avec les femmes écrouées. A plus de 200 km de Kaolack, Rufisque et sa prison des femmes. Ici est enfermée la seule femme condamnée à perpétuité dans tout le Sénégal. Elle ne comprend d’ailleurs toujours pas la définition de la perpétuité et la prononce encore très mal.
«Lorsque le juge a prononcé pétpéti (sic), je me suis effondrée. On me dit que je dois purger une vingtaine d’années de prison, mais j’ai le sentiment que je ne sortirai jamais d’ici», dit Mariama*. Elle est la complice de Souleymane dans le crime d’empoisonnement. Mariama donne l’impression de ne pas savoir ce qui lui arrive. Elle triture son châle, se tient dans une attitude craintive et parle d’une voix basse et altérée. Le mur qui la tient enfermée dans son subconscient est plus haut que le mur d’enceinte de la prison de Rufisque.
La faute à un abandon imposé par son mari, ses enfants, sa famille. Durant tout le processus qui l’a menée à une condamnation à perpétuité, Mariama n’a jamais bénéficié du soutien des siens. Seulement de celui d’un voisin qui l’a encouragée lors de son procès. «Et c’est tout», souffle-t-elle en baissant les yeux. Longtemps elle n’a eu que le numéro de téléphone de son mari pour maintenir un semblant de lien avec ses enfants et puis, son époux est mort.
Son aîné a bien essayé de reprendre contact avec elle, mais sa dernière visite remonte à quatre ans. Pour ne pas sombrer, elle a donc appris le tissage et passe ses journées à ses ouvrages. Sa seule échappatoire dans ce double mur qui la tient enfermée depuis 9 ans déjà. Une goutte dans une sentence à perpétuité.
AICHA FALL ET NDEYE FATOU SECK
L’OBS