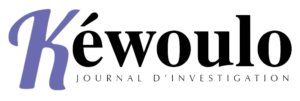Après avoir vaincu le coronavirus, les patients doivent encore lutter pour leur réadaptation. Les séquelles sont physiques mais peuvent être aussi psychologiques.
Ils ont survécu mais ne sont pas sortis indemnes de ce combat sans vainqueur.
“Vous vous retrouvez dans un tel état de vulnérabilité que vous avez rapidement l’impression de tomber en déchéance”, murmure Jérôme, qui a fêté ses 66 ans dans une chambre d’isolement avec double sas à Bichat (Paris, 18e) où il a été hospitalisé un mois.
Pour ne pas perdre ce qui faisait encore de lui un homme, il s’est astreint à se lever et prendre sa douche chaque jour. “Faire couler l’eau et le savon sur mon corps me donnait le sentiment de redevenir normal.” Jérôme n’a jamais baissé les bras. Même lorsqu’il est tombé à 15 litres d’oxygène par heure et que les médecins lui ont proposé de l’intuber pour mieux l’assister. “Je voulais pouvoir continuer à me battre.”
Une nuit, il a été réveillé par le brouhaha des équipes qui allaient et venaient dans d’autres chambres : la mort était au bout du couloir. “Le matin, une infirmière est venue m’expliquer qu’ils avaient perdu certains de mes voisins et elle m’a demandé si je voulais parler avec un psy”, se souvient Jérôme, qui a décliné la proposition avec philosophie : “On est né pour mourir même si on n’est pas forcément prêt.”
XXX
Premier cas positif au coronavirus recensé à Versailles (Yvelines), il a pu quitter l’hôpital il y a un mois à condition de suivre à domicile un protocole visant à lui faire récupérer sa capacité respiratoire : 80 à 120 exercices quotidiens pendant quinze jours pour libérer ses bronches et retrouver une élasticité pulmonaire.
“Ma mécanique n’a pas encore récupéré entièrement, nous confie Jérôme. J’ai perdu aussi de la masse musculaire. Moi qui suis très sportif, dès que je fais quatre tours de jardin, je suis crevé.” Il murmure : “ce virus, c’est le diable équipé de ventouses qui s’accroche aux bronches, ne vous lâche pas et vous détruit.”
A l’hôpital Bicêtre (Paris, 17e), une unité a été créé il y a deux semaines, dans un bâtiment à distance de celui abritant la réanimation et les soins intensifs, pour qu’une équipe pluridisciplinaire – neurologue, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute, psychologue – puisse prendre en charge les patients stabilisés qui ne peuvent pas encore être renvoyés chez eux.
Certains sortent de réanimation ou de soins intensifs, d’autres ont une forme de Covid-19 moins sévère mais ont besoin d’un suivi ou ne peuvent pas rentrer, soit pour ne pas risquer de contaminer une personne vulnérable vivant à leur domicile, soit pour des raisons sociales. Ils sont épuisés, parfois fracassés. La plupart souffrent de douleurs liées à l’immobilisation ; leurs muscles ont fondu ; ils ne peuvent pas s’alimenter ni faire leur toilette seuls ; doivent retrouver l’équilibre, réapprendre à marcher…
“Ces patients ont besoin d’être aidés dans la vie quotidienne et accompagnés dans leur rééducation qui doit se faire par étape”, indique le Dr Cécile Cauquil, neurologue, mobilisée sur cette unité. L’équipe facilite aussi le retour à la maison des patients en mettant notamment en place des aides à domicile pour ceux qui sont seuls et ne seront pas en mesure de faire leurs courses ou même leur toilette une fois chez eux. “Chez certains, il y a une grande appréhension à retrouver l’extérieur : ils ont peur de rechuter, que leur état se détériore”, confie le Dr Cauquil.
XXX
La convalescence est une laborieuse ascension avec deux versants. Physiquement, “je suis encore épuisé”, nous confie Matt, un cadre britannique de 39 ans. “Même si je respire à la nouveau, Je n’ai pas récupéré entièrement ma capacité respiratoire. Je dois encore passer des radios des poumons pour voir si les lésions ne sont pas irréversibles.” Psychologiquement, “j’ai encore des flashbacks de mon transport à l’hôpital, des nuits en soins intensifs, je ressens même le contact du masque à oxygène sur mon visage”.
Matt a passé six jours sous un appareil de ventilation non invasive, dans une salle d’isolement, avec la seule visite de médecins et d’infirmières en combinaisons étanches. “Je me serais cru dans un film. C’était terrifiant…” Les premiers temps, à l’hôpital, ce père de famille avait si peur de mourir qu’il était “pétrifié à l’idée de s’endormir”. Aujourd’hui, il estime avoir eu “beaucoup de chance” d’être revenu “de l’autre côté”. Mais quelque chose en lui s’est cassé. Il compte consulter pour évacuer son stress et ses cauchemars et retrouver “une vie normale”.
Chez certains patients, la notion d’urgence et la peur de mourir ont pu “provoquer un effroi : une glaciation de la pensée qui peut entraîner un psycho-traumatisme”, indique Marie-Frédérique Bacqué, professeur de psychopathologie clinique à l’université de Strasbourg. Si le patient a été soumis à une hospitalisation très rapide, s’il a senti que sa vie était menacée, “un état d’hypervigilance se met en place.
Notre cerveau enregistre de manière très précise la scène qui précède et, en cas de traumatisme, ce film va rester et revenir comme si le cerveau cherchait à les revivre pour trouver une solution.” Si ces manifestations perdurent au-delà d’un mois, on parle alors de stress post traumatique.
Les troubles sont “semblables à ceux qui peuvent survenir chez des personnes exposées à une agression ou à un attentat, explique le Pr Cédric Lemogne,
chef du service de psychiatrie de liaison de l’hôpital Beaujon : des reviviscences, souvent par bribes, de moments vivaces mais incomplets de l’expérience traumatique. Cela peut même se traduire par des moments de dépersonnalisation et des manifestations physiques d’anxiété :
des tremblements, une fréquence cardiaque élevée. Et c’est suffisamment pénible pour que la personne développe des conduites d’évitement, ce qui peut générer un handicap social, professionnel, familial…” Toutefois, de tels troubles n’affectent “qu’une minorité de patients”, insiste le psychiatre “mais cela justifie une attention particulière car des traitements validés existent”.
Ceux qui ont été infectés par le Covid-19 peuvent aussi passer par un état dépressif. “La sensation d’extrême vulnérabilité, la perte de son insouciance, parfois de proches qui eux n’ont pas survécu, peut donner le sentiment que sa propre existence est vide de sens”, relève Marie Frédérique Bacqué,
qui travaille depuis de nombreuses années sur le deuil et la mort d’un point de vue anthropologique, les représentations collectives de la maladie, en particulier de l’épidémie. “Dans notre société, nous mettons la mort à distance”, relève la psychologue, rappelant que l’Insee a comptabilisé 612 000 décès toutes causes confondues en 2019.
“Il serait bénéfique que cette épidémie puisse nous faire réfléchir à notre mort, non pas de manière catastrophiste mais sous une forme philosophique, sensible, poétique… La mort n’est rien. La perte, c’est tout.”