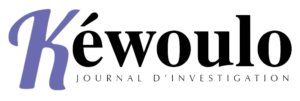Nous sommes à l’entrée principale, devant la bâtisse, qui a dû être reconstruite deux fois. C’est que les enfants, dans leur révolte, ont réussi à deux reprises à la détruire par le feu. C’est par cette entrée principale, donc, que les enfants arrivaient pour la première fois au pensionnat. C’est là, aussi, qu’on prenait les photos officielles. Le reste de leurs années de séjour, elle leur sera interdite. La première journée, on sépare les filles et les garçons, on leur coupe les cheveux, on leur retire tous leurs vêtements et objets personnels, et on assigne à chaque enfant un numéro. Dorénavant, on ne leur adressera la parole qu’avec leur numéro. Ils dormiront, mangeront, travailleront, s’assoiront dans l’ordre de leur numéro. On s’assure par ailleurs de donner aux membres d’une même fratrie des numéros éloignés les uns des autres.
Juste à gauche se trouve le parloir. Les rares fois où les parents pouvaient leur rendre visite, c’est là qu’on les installait. On avait interdit aux enfants de parler toute autre langue que l’anglais, que les parents ne maîtrisaient pas, le plus souvent. L’enfant avait deux options. Parler sa langue et être frappé et puni plus tard. Ou s’en tenir à l’anglais et ne pas être compris de ses parents. Souvent, l’enfant choisissait le silence complet.
Un peu plus loin, vous avez l’infirmerie. Faute de lits, les enfants malades restaient avec le groupe (à contaminer les autres), à moins d’être vraiment, vraiment incapables de se tenir debout. Les parents n’étaient avertis de la maladie de leur enfant que lorsque sa mort était imminente. Souvent, ils ne pouvaient arriver à temps. Les compagnies pharmaceutiques ont fait à plusieurs reprises des expérimentations dans cette infirmerie. On donnait un traitement encore à l’étude à quelques enfants, on le refusait aux autres. On prenait en notes les résultats.
Un peu plus loin, on se retrouve dans l’escalier principal, en bois verni. Les enfants n’y ont jamais accès, à l’exception de quelques filles qui ont la responsabilité de le nettoyer. Les filles occupent leurs journées aux tâches domestiques : la cuisine, la lessive, le ménage. Elles n’ont pratiquement jamais le droit d’aller dehors. Quelques survivantes se rappellent qu’être assignées au nettoyage de l’escalier principal était un privilège : ça donnait l’occasion de regarder par la fenêtre.
En bas, il y a la cafétéria. On y servait le matin un gruau de base. Les survivants racontent que lorsqu’il était brûlé, ou qu’on y trouvait des vers, on devait tout de même le manger jusqu’au bout. Si on ne finissait pas son bol, celui-ci était rapporté à l’enfant au prochain repas, et à celui d’après, jusqu’à ce qu’il soit terminé. Les garçons travaillaient dehors à traire le lait des vaches, à ramasser les œufs du poulailler, à cueillir les pommes du verger. Le tout était vendu au village, mais il leur était interdit d’y avoir accès.
Un peu plus loin, il y a la salle des fournaises. Juste après, c’est la buanderie. C’est dans ces deux pièces que la plupart des abus physiques et sexuels se sont déroulés, selon les survivants. C’est que les machines y font beaucoup de bruit. Avec le bruit vient la discrétion.
Là, il y a ce corridor, qui servait de salle de divertissement pour les employés. Au milieu de la nuit, on allait chercher des garçons dans leur lit. On fermait les portes aux deux extrémités du corridor et on les forçait à se battre, en prenant des paris, jusqu’à ce qu’il y ait K.-O. L’enfant perdant était forcé de laver les traces de sang sur les murs et sur les planchers avant de se recoucher. Les tuyaux au plafond de ce corridor étaient aussi pratiques, pour y menotter les enfants qui devaient subir des châtiments corporels.
À chaque extrémité du sous-sol, on trouve les salles de jeu. Une pour les filles, une pour les garçons. On n’y trouvait par ailleurs aucun jeu ou jouet. L’espace était toutefois commode pour y entasser les enfants pendant que les employés se reposaient. Le plafond y est encore sillonné par la même tuyauterie. Des survivants racontent que, lorsqu’un des plus petits ne pouvait s’empêcher de pleurer, les plus grands l’aidaient à grimper sur le dessus des casiers, pour qu’il s’agrippe aux tuyaux d’eau chaude, en imaginant qu’il s’agissait de sa mère. On dit que ça avait un effet calmant.
Tout ceci, et bien, bien d’autres choses encore, on vous le racontera si vous participez à une visite du Mohawk Institute, le pensionnat autochtone de Brantford, Ontario, ouvert de 1828 à 1970. Depuis 1972, il est rouvert au public sous le nom de Centre culturel Woodland, afin que jamais, jamais, on n’oublie. Enfin, il l’était, accessible : avec le passage des années, et les dommages au toit, le Centre a dû lancer une campagne de financement, Save the Evidence, dans le but d’effectuer les réparations nécessaires. Pourquoi est-ce aux citoyens sensibilisés d’organiser des collectes de fonds pour sauver, petit à petit, l’un des seuls ex-pensionnats pour Autochtones devenus musée ? N’y a-t-il pas un devoir de mémoire collective dans ce pays ? Mystère. Vous pouvez toujours effectuer une visite virtuelle, toutefois, en attendant la réouverture complète.
Nous en sommes à la troisième semaine de la campagne électorale. En plus des quelque 3200 enfants décédés identifiés par la Commission de vérité et réconciliation, on a retrouvé, depuis mai dernier, plus de 1300 dépouilles à proximité des anciens pensionnats. Bien des fouilles sont encore en cours. Après les premières (re)découvertes, les annonces qui ont suivi ont attiré de moins en moins d’attention. Nous sommes passés à autre chose. Ce pays s’est habitué — oui, habitué — à retrouver des corps d’enfants en quelques semaines à peine.
Qu’est-ce que ce silence et cette habituation rapide à l’horreur signifient réellement ? Ne trouvez-vous pas que, dans les circonstances, le peu de place accordé dans cette campagne à la question des pensionnats et de la justice envers les peuples autochtones est… particulier ?
Emilie Nicolas, Le Devoir.