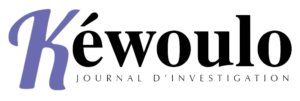Dans sa préface au livre Auassat, à la recherche des enfants autochtones disparus, d’Anne Panasuk, l’Anichinabé Richard Ejinagosi Kistabish parle d’un « crime parfait ». Il raconte comment, alors qu’il agissait comme agent de liaison et de traducteur pour le ministère des Affaires indiennes en 1971, on lui avait demandé d’aller faire signer des formulaires aux parents pour que leurs enfants puissent aller au pensionnat. Dans ces formulaires, une toute petite clause, au verso, stipulait que le parent donnait ainsi « la permission et l’autorisation au représentant de la Reine de prendre toutes les décisions concernant le bien-être de mon enfant, en éducation, en santé et toute autre question le concernant ».
« C’est une formule de consentement d’abandon d’autorité [parentale] », écrit Richard Kistabish, qui, après avoir découvert cette clause, a refusé de faire signer le formulaire aux parents.
Cette pratique, comme bien d’autres qui dépossédaient les parents autochtones de toute autorité, est documentée par Anne Panasuk, dans ce récit qui porte les fruits de plusieurs enquêtes qu’elle a menées alors qu’elle était journaliste à l’émission Enquête, de Radio-Canada, et dont elle a fait aussi une série de balados, Le chemin de croix.
 Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Photo: Jacques Nadeau Le DevoirCette enquête commence en 2014, sur les traces de neuf enfants innus originaires de Pakua Shipi, et disparus lors d’un séjour à l’hôpital de Blanc-Sablon. Puis, elle part sur la piste d’enfants atikamewk de Manawan, notamment une petite Lauréanna Echaquan, que ses parents ont emmenée alors qu’elle était bébé à l’hôpital de Joliette, à 200 kilomètres de chez eux. Lorsqu’on leur apprend le décès de leur bébé, quelques jours plus tard, les parents retournent à Joliette pour identifier le corps, mais ne reconnaissent pas celui qui leur est présenté.
« Ils ont vu une enfant qui était plus grande que Lauréanna », écrit Anne Panasuk. Leur enfant, qui avait pourtant été baptisée, aurait été enterrée à l’extérieur du cimetière de Joliette, selon les témoignages des parents, mais aussi d’un témoin retrouvé par Anne Panasuk. A priori, l’histoire semble invraisemblable. « Quand je raconte les histoires horribles de nos vies, on me répond toujours que ce n’est pas croyable », prévient Richard Ejinagosi Kistabish en préface.
Anne Panasuk elle-même doutait de l’histoire de l’enterrement de Lauréanna à l’extérieur du cimetière, jusqu’à ce qu’un témoin oculaire, une travailleuse sociale qui vit aujourd’hui aux États-Unis et qu’elle a jointe là-bas, lui confirme les faits. Qui plus est, écrit-elle, « à ce jour, le nom de Lauréanna figure encore sur la liste des Indiens inscrits au ministère des Affaires autochtones ».
Quand je raconte les histoires horribles de nos vies, on me répond toujours que ce n’est pas croyable.
Pour en avoir le cœur net, dit Anne Panasuk en entrevue, il faudrait « aller exhumer le corps enterré en dehors du cimetière, puisqu’on sait où il est ». Anne Panasuk, récemment retraitée de Radio-Canada, est maintenant conseillère spéciale au ministre des Affaires autochtones pour le soutien aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés. « Mais dans mon mandat, je ne fais rien sans que les familles le demandent. »
Soutien à la demande des familles
« Comme conseillère, j’aide à la mise en place de la nouvelle loi 79, qui est en vigueur depuis le 1er septembre », explique-t-elle. La nouvelle loi, adoptée dans la foulée de la découverte de centaines de dépouilles d’enfants autochtones près de pensionnats, déverrouille notamment toutes les archives médicales et religieuses du Québec. Elle prévoit un soutien aux familles autochtones qui sont à la recherche de membres de leurs familles disparus, ou qui voudraient faire des demandes d’exhumation dans le cadre d’une recherche d’enfant. Elle rend également possible, sur autorisation du ministère de la Culture, l’utilisation de radars pénétrants pour localiser desdépouilles. Selon Anne Panasuk, plusde 200 enfants pourraient faire l’objet de recherches dans le cadre de cette loi.
Autre démonstration de l’esprit de l’époque, la sœur de Lauréanna, Alice, qui est toujours vivante, a été retirée à ses parents à sa naissance en 1972, à Manawan, pour être envoyée à l’hôpital de Joliette à cause d’un handicap. L’année suivante, une travailleuse sociale ramenait Alice au village pour leur faire signer une autorisation d’adoption, que les parents ont refusée.
Le cas de Diane Petiquay, dans la communauté atikamekw de Wemotaci, est encore plus choquant. La petite Diane a été envoyée par avion à l’hôpital de La Tuque, alors qu’elle avait six mois, pour une pneumonie. À l’époque, et c’était encore le cas tout récemment pour les communautés du Grand Nord, les parents n’étaient pas autorisés à se rendre à l’hôpital avec leur enfant. Diane,qui est devenue entre-temps Diane Arviset, parce qu’elle a été adoptée, n’a retrouvé sa famille qu’à sa majorité.
Selon le témoignage de sa mère, c’est le curé oblat Jean-Marc Houle, qui aurait d’ailleurs agressé sexuellement des Autochtones de la communauté, qui lui a fait signer un formulaire d’abandon d’enfant en prétendant que c’était un formulaire pour obtenir des soins pour Diane.
En entrevue, Anne Panasuk reconnaît par ailleurs que, dans certains cas, les interventions de placement d’enfant étaient faites de bonne foi, mais dans l’ignorance des réalités autochtones. « Il y a des cas où l’enfant est envoyé à l’hôpital et les parents n’allaient pas le visiter, parce qu’ils n’en avaient pas les moyens. À Wemotaci, les distances sont énormes. Il fallait faire du canot pendant deux jours pour arriver au chemin de fer. Alors les enfants étaient laissés et il était décidé par les services sociaux que l’enfant était abandonné », dit-elle.
Perte de confiance
« Nous étions sur tout le territoire et ils savaient où nous trouver ! » proteste Richard Kistabish en préface. Après des décennies de drames, de familles disloquées à jamais, de traces dissimulées, doit-on s’étonner que des familles autochtones ne fassent plus confiance au discours officiel ?
« À partir de là, les cas s’accumulent devant moi. On me parle désormais bel et bien d’enfants enlevés. Des enfants disparus pendant plusieurs années, qu’on a retrouvés dans des familles d’accueil, adoptés sans le consentement éclairé de leurs parents… Ces histoires alimentent les soupçons d’autres familles qui ont vu disparaître leurs enfants et gardent le fol espoir de les retrouver », écrit Anne Panasuk.
À défaut de les retrouver vivants, les familles qui le souhaitent pourront peut-être, enfin, entamer un deuil rendu impossible par le silence.
Le Devoir.