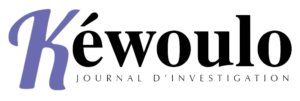Le Sénégal, un pays riche en traditions ancestrales et en diversité culturelle, se trouve actuellement à un tournant décisif pour l’avenir de son secteur agricole. Bien que l’agriculture joue un rôle crucial dans l’économie nationale, des obstacles socio-culturels profondément enracinés continuent de freiner son développement optimal.
Ces défis, ancrés dans l’histoire, les us et les coutumes locaux, nécessitent une approche nuancée pour être surmontés. Il est intéressant de noter par exemple des programmes gouvernementaux en matière de vaccination des enfants, de scolarisation des filles ou encore d’hygiène qui sont souvent accompagnés par de fortes composantes de communication sociale visant à encourager des changements de comportements.
Dans les régions rurales du Sénégal, les méthodes ancestrales de culture continuent de prévaloir. Par exemple, à Ndiaffate dans la région de Kaolack, les agriculteurs persistent à utiliser des semences locales moins productives, malgré la disponibilité de variétés améliorées. Cette préférence pour les techniques traditionnelles est souvent alimentée par une méfiance envers les nouvelles technologies.
À Thiès, un projet d’irrigation goutte-à-goutte a échoué car les agriculteurs pensaient que les promoteurs cherchaient à les tromper.
La dépendance des agriculteurs sénégalais vis-à-vis des subventions et aides de l’État, constitue un autre frein majeur. À Kaolack, les producteurs d’arachides ont retardé leurs semis en attendant des semences subventionnées, ce qui a conduit à une récolte tardive et moins abondante. Cette attente des aides étatiques peut freiner l’initiative individuelle, le principe d’entreprenariat et retarder les progrès agricoles.
Les chefs traditionnels et les anciens jouent un rôle déterminant dans les décisions agricoles, souvent au détriment de l’innovation. À Ziguinchor, un projet de diversification des cultures a été abandonné car les anciens insistaient sur la culture exclusive du riz. Le poids des traditions peut ainsi limiter l’adoption de pratiques agricoles plus diversifiées et rentables.
Certaines croyances culturelles influencent également les pratiques agricoles. À Fatick, des agriculteurs ont refusé d’utiliser des engrais, affirmant que la fertilité des sols dépendait de la volonté divine. Cette croyance en la providence peut réduire l’adoption de pratiques modernes et limiter les rendements.
Les cérémonies traditionnelles retardent parfois les récoltes, affectant la qualité des produits. À Tambacounda, une cérémonie de bénédiction des récoltes a retardé la moisson du mil, entraînant des pertes dues aux intempéries. Bien que significatives sur le plan social, ces pratiques peuvent avoir des conséquences économiques négatives.
La priorité accordée aux cultures vivrières traditionnelles, comme le mil et le sorgho, au détriment des cultures commerciales plus rentables, limite les revenus des agriculteurs. À Matam, les tentatives d’introduire la culture de la tomate industrielle ont été rejetées en faveur du mil. La rationalité paysanne voit aussi les tiges de mil et sorgho comme matériaux de construction de l’habitat en plus des graines pour l’alimentation quotidienne du ménage. Cette valorisation des cultures vivrières, bien que cruciale pour la sécurité alimentaire, restreint les opportunités économiques.
Les innovations agricoles sont parfois perçues comme des menaces à l’identité culturelle. À Bakel, l’introduction de tracteurs a été mal accueillie car les agriculteurs craignaient que cela ne détruise leur mode de vie traditionnel basé sur le travail manuel, en plus de la non disponibilité de moyens financiers pour faire face à la consommation en carburant. Cette stigmatisation des innovations et la non prise en compte des capacités financières pour l’exploitation, freine l’adoption de technologies qui pourraient améliorer l’efficacité et la productivité.
Les femmes, bien que cruciales dans l’agriculture sénégalaise, sont souvent marginalisées dans les prises de décision. À Kolda, un groupe de femmes a été empêché de participer à un programme de formation en agriculture durable, les hommes de la communauté estimant que leur place était au foyer. Cette exclusion limite l’efficacité des initiatives agricoles et prive le secteur de contributions précieuses.
Il est également important de noter que l’intégration des jeunes dans le secteur agricole est essentielle pour assurer la pérennité des innovations et des pratiques modernes. Les jeunes agriculteurs, souvent plus ouverts aux nouvelles technologies, peuvent jouer un rôle clé dans la transformation du secteur agricole sénégalais. Des programmes de mentorat et de formation ciblés, peuvent aider à combler le fossé générationnel et à encourager l’adoption de pratiques agricoles plus efficaces et durables.
La transmission orale des connaissances agricoles limite aussi l’accès à des informations actualisées et scientifiques. À Louga, les jeunes agriculteurs continuent de suivre les conseils de leurs aînés, ignorant les formations modernes disponibles. Cette dépendance sur la transmission orale freine l’innovation et l’adoption de nouvelles techniques.
Inclure les femmes et les jeunes dans les processus décisionnels et leur fournir les ressources nécessaires est également crucial.
Pour réussir les objectifs de souveraineté alimentaire, il est impératif de mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation qui respectent les traditions tout en introduisant progressivement des innovations. Les autorités en charge de l’encadrement paysan, doivent collaborer étroitement avec les chefs traditionnels pour gagner leur confiance et leur soutien. Enfin, il est essentiel de promouvoir des pratiques agricoles modernes tout en respectant les croyances locales, en montrant comment ces nouvelles méthodes peuvent coexister avec les traditions et améliorer les rendements agricoles. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place des stratégies de communication sociale efficaces, de renforcer les capacités des agriculteurs à travers des formations continues, et de créer des plateformes de dialogue entre les différents acteurs du secteur agricole
En adoptant une approche inclusive et participative, le Sénégal peut surmonter ces obstacles et promouvoir une agriculture durable et prospère, assurant ainsi sa souveraineté alimentaire et son développement économique.
En combinant tradition et modernité, le Sénégal peut non seulement améliorer la productivité agricole mais aussi garantir une sécurité alimentaire durable pour les générations futures.
En conclusion, la révolution agricole au Sénégal nécessite une approche holistique qui respecte les traditions tout en intégrant des pratiques modernes et innovantes, surmontant les obstacles socio-culturels et favorisant une participation inclusive de tous les acteurs.
Par Dr Idrissa Doucouré. Président du Conseil Mondial des Investissements et des Affaires, Londres
PhD, Exécutive MBA, et Ingénieur











![[Billet d’humour] Le Maroc réussit sa panenka… carcérale !](https://i0.wp.com/kewoulo.info/wp-content/uploads/2026/02/suporter-senegal.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)