C’est l’un des pires drames civils de l’histoire de la guerre en Casamance, au sud du Sénégal. Un jour, dix garçons décident d’aller dans la forêt de Bissine, à une dizaine de kilomètres de leur village, Diagnon (commune d’Adéane, département de Ziguinchor) pour couper des planches de bois à revendre. Aucun d’entre eux ne rentrera plus jamais chez lui. Surpris en pleine brousse par les rebelles du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc), ils ont été tous abattus d’une rafale à la tête. Un carnage sans précédent, qui a engendré de graves problèmes psychiques et psychologiques au sein de la population. Reportage.
Mamadou les a aperçus, tous à terre, de gros trous dans la tête, des morceaux de cervelle éparpillés dans le feuillage. Dix corps inertes giclant encore du sang, jambes et bras cassés et les visages comme tailladés à la hache. Une odeur d’abattoir, des morceaux de chair et d’organes collés aux arbres, des impacts de balles et un tapis rouge sang qui porte des empreintes de bottes. Mamadou est resté figé un moment et ses yeux éberlués ont filmé l’horreur en gros plan.
Puis il a relevé sa moto, qu’il avait abandonnée par terre, le moteur toujours en marche, et a repris le chemin du village, la main a fond sur l’accélérateur. Cinq minutes de route, de peur et de pleurs. Un retour en catastrophe. Un étrange moment de silence. Un corps qui tremble, des muscles qui ne tiennent plus, un cerveau qui divague. «Ils les ont tués !!!! Ils les ont tués !!!», crie-t-il, avant de s’effondrer. Un parent amène de l’eau. Un autre des gris-gris. On croit qu’il a croisé un fantôme. A deux, ils tentent de le réanimer. Sans aucune réussite. «Ils sont là-bas, là-bas, là…», a enchaîné Mamadou, le souffle coupé, avant de tomber dans les vapes.
Là-bas, c’est dans la forêt de Bissine. Une jungle touffue, bordée de champs de riz et de carrières. Une petite Amazonie peuplée de monstres en bois et de bassins fluviaux, chasse gardée des rebelles du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc). Une horde d’irrédentistes renforcés de sanguinaires mercenaires qui ont fait les guerres du Liberia, de l’Angola ou de la Sierre Leone. Une impitoyable bande de chasseurs de primes, trafiquants occasionnels de drogues de toutes sortes, qui attaquent, pillent, mutilent et tuent. Sans pitié.
Au nom d’une guerre d’indépendance du sud du Sénégal qui n’a jamais laissé entrevoir la moindre lueur d’espoir. Après plus de trois décennies de conflit armé, les rebelles n’ont encore conquis aucune parcelle de terrain. C’est dans la peur qu’ils opèrent. Et dans la violence qu’ils prospèrent.
Balles en pleine tête
«Abats-le», a hurlé le chef. La rafale est partie et a atteint la jambe de Bouba. Les projectiles lui ont broyé le tibia. A terre, le garçon souffre. Il pleure et supplie le combattant de ne pas lui ôter la vie. Comme toute réponse, l’homme avance jusqu’à sa hauteur. Il le nargue du regard, avant de l’achever d’une longue rafale. «Il est décédé suite à un traumatisme ouvert de la tête, orifice d’entrée des projectiles au niveau du flanc droit, fracture ouverte de la jambe droite», conclura, plus tard, le Dr Jacques Senghor, chirurgien orthopédiste, traumatologue et médecin légiste de l’hôpital de Ziguinchor. Le même sort est réservé aux 9 autres garçons qui ont osé pénétrer à Bissine pour y couper des planches de bois. La deuxième victime du peloton d’exécution a reçu un coup de cross à la mâchoire. Un craquement. La bouche dans la boue. Une tentative de relèvement.
Quelques crachats de sang et de fragments de dents. Et le corps qui danse au rythme des balles. «Il faut en finir aussi avec les autres», a encore ordonné le chef, impitoyable. Et à chaque fois, c’est le même rituel sanglant. Le même procédé effroyable : le bruit de la mitraillette, un crâne déflagré, un corps projeté à terre, des cris, des prières. Mais aucun répit. «Ça s’est passé pareil que dans les films de guerre, où on exécute les otages de la pire des manières. Je crois qu’ils ont les images horribles de ce film sur la guerre civile en Sierra Léone, où les rebelles du Ruf en lutte pour le contrôle des mines diamantifères, exécutaient les populations, en signe de représailles contre l’Armée loyaliste (Blood Diamond). C’est exactement ça qu’ils ont voulu reproduire», tente d’expliquer Sékou Mané, chef de village de Diagnon. Le quinqua, qui en paraît beaucoup moins, a le regard lointain. Les souvenirs encore vivaces de la joyeuse vie de la bande à Bouba. Sur leur dernière rencontre. Le jour où il les a entendus déchirer le silence de la nuit. C’était le 20 octobre 2011. La veille du carnage.
Ce soir-là, la lune était absente de Diagnon et le ciel avait pris quelques heures de congé. Des jours de fortes pluies, à inonder les champs de riz et à confiner tout le village dans ses fameuses cases aux toits de chaume, il avait décidé, très brusquement, d’être coopératif, de fermer ses vannes. Mais, comme un multirécidiviste connu des services de police, personne n’a cru à sa bonne foi. Trop beau pour être vrai. Les premiers qui ont osé se risquer dehors, il a libéré sur eux un crachin à vous filer la grippe. C’étaient encore le confinement des jours passés, la traumatisante pénombre, l’insoutenable moiteur des chambres. Un régime de bagne en zone tropicale, très difficile à supporter. Mais pour les jeunes du village, habitués à palper le corps mouillé de la nuit, l’appel aéré du dehors est irrésistible. Le regroupement se fait par de petits sifflements, un code sonore indéchiffrable par les oreilles allochtones.
Quelques minutes plus tard, plus d’une quinzaine de potes, tous de la même génération, se bousculent dans la boutique de Mamadou Camara. Une bâtisse à l’ancienne, aux murs défraîchis et à plus de la moitié arrimée de marchandises en tous genres. Ce carré débout au milieu du village est le point de repère de tous les jeunes. Les retrouvailles ont l’air d’un petit Conseil de la jeunesse qui s’ouvre sur les vastes difficultés financières qui étreignent Diagnon. Les greniers sont vides. Les parents sont sans le sou et la période des récoltes est encore lointaine. Il faut agir, faire quelque chose pour éviter le pire. La famine. Boubacar Sonko alias Bouba est le premier à élever la voix. Le garçon est un brut de décoffrage. Une montagne de muscles, plus doté sur la balance que sous la toise.
Né en 1987 à Franceville où son papa, Landing Sonko, menuisier-ébéniste, faisait partie du premier contingent de travailleurs sénégalais envoyés au Gabon pour la construction de ses édifices publics, Boubacar est rentré de l’Afrique centrale avec le goût de la forêt. Sa chance : il a été éduqué dans la langue de ses parents, le manding, et a hérité du métier de son pater. Donc, quand ses copains le pressent de faire sa proposition, Bouba ne se triture pas les méninges. Il tend le bras, éclairé d’une lampe à pétrole, en direction de l’inépuisable forêt de Bissine. Personne ne trouve à redire. C’est adjugé. Il se fait tard, le temps n’est pas à déblatérer davantage. «Non Nouah, on en parlera demain», a coupé net le reste de la bande, trop pressé d’aller au lit. Mamadou a une dernière information à livrer. Il ne partira pas le matin de bonne heure, pas avec la bande, mais il promet de les rejoindre plus tard et de leur apporter le petit déj. C’est ok. La séance est levée.
«Ils ont tué mon fils. Ils ont tué mon espoir»
Le jour s’est pointé, brumeux. Sur les toits des cases qui pleurent les dernières gouttes de rosée, s’échappent quelques ballons de fumée. Dans les concessions, il pue une odeur de Mono. La recette matinale du coin. Une bouillie de mil à absorber chaud et sucré. Souvent avec du lait caillé. Parfois sans. Les femmes sont en pagne, les vieux en caftan. Chéchia sur la tête, la bouche psalmodiant des versets du Coran. Signe de la percée de l’Islam dans ce coin d’animisme. Dehors, les rues sont encore désertes. Des coqs, une chèvre et un énorme brouillard. Devant la boutique de Mamadou, qui vient à peine d’ouvrir ses portes, l’équipe de Bouba se forme. Des salamalecs, quelques instants de chambrettes, une grande complicité. «On y va», ordonne Yacouba. Le ton sec. Le jeune homme est un soldat dans l’âme.
Comme dans la vie. Libéré de l’Armée après sa durée légale de 2 ans, il vient d’être admis au concours d’entrée dans la Gendarmerie. Et le temps de rejoindre l’école de formation, il est revenu se ressourcer au village. «Oh Yacouba, il faut arrêter avec tes affaires de soldat. On n’est pas au camp. Personne n’est ton fils ici. Il faut quand même qu’on se ravitaille en cigarettes», a répliqué Aliou. Youssouf a explosé de rire. Yacouba n’a pas forcément aimé. Mais toute la bande s’est moquée. «On déconne juste, faut pas trop se prendre la tête», a souri le cousin Bouba, histoire de purger l’atmosphère, de remettre tout à plat. Les minutes s’égrènent, interminables. Puis commence la marche groupée vers Bissine. L’incursion, plutôt. La forêt est détrempée, danse, piégeuse.
Il faut parfois contourner des pistes boueuses, se frayer un chemin entre les étangs, en élaguant branches et lianes pour atteindre la mine de bois. Il faut surtout se couvrir mutuellement, un peu comme dans les forces spéciales en opération commando. Ici, le danger est partout : sur les ramures, sous l’épais tapis herbacé, dans le plus petit trou qu’on effleure du pied. Il est volant, rampant. Vertébré, invertébré. Et rarement humain. Mais quand il épouse la forme humaine, il est toujours armé. Féroce, barbare, cruel. «Les gars, cet arbre-là peut faire l’affaire. Je l’avais déjà repéré. Il suffit de bien l’inciser pour se faire beaucoup d’argent», a dit Bouba, avec la voix du parfait connaisseur. «Si tu le dis», a répondu Nouah. Avant d’enchaîner, enthousiaste : «Mais il faut qu’on s’y mette tout de suite.
On doit bien avancer avant l’arrivée de Mamadou.» Et le fameux colis. Mais à la place du jeune boutiquier portant sur le dos de son scooter des miches de pain, de l’eau, du thé et du sucre, c’est une horde de rebelles qui a subitement fait irruption. La bande est armée de fusils automatiques et a un but : marquer les esprits des populations, surtout des garçons indélicats qui nourrissent encore l’idée de venir couper du bois sur leur… territoire. Pas d’excuses ni de tolérance. Il faut tuer, de la pire des manières, éventrer, découper, démembrer s’il le faut, pour que cela fasse tache dans la mémoire collective. Opération réussie. Puisque quelques heures après la sauvagerie de Bissine, le message est perçu dans le village. Cinq sur cinq.
«Woooouye !!! wooouye !!! Ils ont tué mon fils. Ils ont tué mon espoir», a crié la maman de Youssouf. Comme une fêlée du ciboulot, elle fait le tour du village en se tapant la tête pour évacuer sa douleur. Et quand elle traverse le marché tenu par les femmes, pas encore au courant de la terrible nouvelle, la foule a frémi. Puis a sursauté, la bouche pleine d’interrogations. «Qu’est-ce qui se passe ?», demandent certaines. «Calme-toi et dis-nous ce qui te fait souffrir autant ?», tempèrent d’autres. Ami Sonko a continué dans ses pleurs, tenaillée par la douleur. Soudain, elle explose de chagrin et entre dans un triste monologue : «Ils l’ont tué mon Youssouf. Ils ont emporté mon aîné. Sur qui est-ce que je vais compter maintenant ? Dites-moi, qui va s’occuper de moi ?»
De l’autre côté du village, d’autres sanglots se font entendre. Encore une voix de femme qui pleure sa chair. Nani Dramé est la mère de Aliou. Elle vient d’être informée du décès de son fils et elle n’a plus envie que d’une chose : se suicider. Mourir, partir rejoindre son fils chéri et son mari, décédé, lui aussi, il n’y a pas longtemps. «Pourquoi resterai-je en vie ? Pour être avec qui ? Non, non, je ne pourrai pas vivre avec ça !», pleure-t-elle. Encore et encore. Et bientôt, c’est tout le village qui entre en transe. Dix morts, c’est beaucoup ! Et dans chaque concession, ou presque, on compte une victime. On pleure un fils, un neveu, un ami, ou une simple connaissance. Le mal est partout.
Il ronge les femmes et accroît le désir de vengeance des hommes. Vite, très vite, la résistance s’organise. Les couteaux sont sortis des fourreaux, les carabines en dessous des lits. Diagnon se mobilise. Il veut marcher sur Bissine, guerroyer avec les rebelles et ramener les corps profanés de ses enfants qui gisent dans la forêt, risquant d’être dévorés à tout moment. «Personne ne sortira du village», a dit un caporal de l’Armée. L’homme de troupe est intransigeant. Les ordres sont clairs. Il n’est pas question de passer outre. En plus, c’est une question de sécurité. Il y a des endroits dans la forêt qui sont truffés de mines et un guet-apens n’est jamais loin. «On ira à Bissine quoi qu’il en soit», crie la foule de guerriers, décidés à partir. Les esprits s’échauffent. L’Armée tempère, mais ne cède guère. Le Président de la communauté rurale et le chef du village sont appelés en renfort pour calmer les nerfs. Après quelques minutes de discussions intenses, le calme est revenu. Un périmètre de sécurité est établi à l’entrée du village. Puis, les militaires partent à la recherche les corps.
«Il ne pouvait pas se relever de ce drame»
Aucun civil ne fait partie du voyage. Pas même les parents des victimes. Et dans les jeeps des soldats, devancés par les Automitrailleuses légères (Aml), ça ne rigole pas. Il y a presque autant d’hommes que d’armes lourdes. Et quand le commando s’élance vers la forêt, c’est un fort sentiment de sécurité qui dissipe les rancœurs de la foule. Mais pas leur grande souffrance. «Ils n’ont pas perdu de temps. Ils sont revenus avec les corps des gosses, arrimés dans une voiture des sapeurs-pompiers. J’étais le seul avec le Pcr et le sous-préfet de la zone, à franchir la barrière de sécurité pour voir les dépouilles.
J’étais derrière le sous-préfet quand je l’ai entendu s’écrier : «Ohhh !!!» A l’instant, j’ai su que c’était quelque chose de terrible. Et quand à mon tour, j’ai fait face aux corps, j’ai failli vomir. Ils étaient pâles, ensanglantés et sans visage. Moi qui les connaissais tous, je ne pouvais plus les reconnaître d’un simple coup d’œil. J’ai juste reconnu Nouah, parce qu’il était infirme du bras.» Face à cette horreur, la décision est vite prise. Les corps ne seront pas rendus aux familles. On ne les verra pas, non plus, sur place. Il faut transférer les dépouilles à l’hôpital de Ziguinchor. D’abord pour autopsie.
Ensuite pour trouver des psychiatres capables de parler aux parents. «A mon arrivée, l’hôpital était plein à craquer, se souvient encore, meurtri, Landing Sonko, papa de Bouba. Il fallait jouer des coudes pour entrer. Il y avait, comme d’habitude, les forces de l’ordre et les journalistes. J’ai été reçu par un monsieur et après une courte discussion, on m’a conduit dans une salle pour me montrer le corps de mon fils (Bouba), ceux de mon neveu (Yacouba) et du fils de mon grand-frère (Youssouf). C’était difficile à voir et pour atténuer la douleur des parents, ils avaient mis des sacs en plastique noirs autour de leurs têtes. C’était vraiment dur !» Mais ce n’est que la première étape d’une longue et énorme souffrance, qui fera, elle aussi, ses victimes. Ses traumatisés et… sa mort.
C’est de l’hôpital qu’on l’a appelé. La voix est traînante, triste. «Tonton, il faut rentrer vite. Sinon, mon père se donnera la mort», lui a dit, au bout du fil, un de ses neveux. Pakéba Djighaly, son demi frère et père de Youssouf, vit des journées sombres et des nuits blanches, depuis l’annonce du décès de son rejeton. Le vieux ne supporte de ne plus entendre la voix de son garçon résonner dans la maison. Il était sa fierté et son confident. Et quand les sages du village se retrouvent à la place publique ou sous les manguiers pour discuter des préparatifs des enterrements, lui, part se refugier dans un petit réduit derrière sa chambre, pour pleurer toutes les larmes de son corps. Il sanglote toute la journée, refuse de s’alimenter et implore Dieu de lui prendre sa vie. «Quand je l’ai retrouvé, il était au bord de la rupture, raconte papa Landing Sonko. J’ai essayé de le conscientiser. Je lui ai dit qu’un jour ou l’autre, nous allons tous y passer.
Que ces rebelles qui ont tué nos enfants, vont, eux aussi, mourir un jour et rendront des comptes. Que le mieux était de se ressaisir et de prier pour qu’Allah les accueille dans Son paradis éternel.» Mais les mots de Landing n’auront aucun effet sur Pakéba. Son état de santé physique et psychologique s’est détérioré au cours des jours qui ont suivi la mise en terre de son fils. Il ne sort plus, ne parle plus et boit juste quelques gorgées de Mono. Juste pour tenir. Il a mal. Trop mal. Et au matin du 40ème jour du décès de son fils, quand tout le village récite le Saint Coran et prie Allah d’épargner ses enfants de la Géhenne, lui est parti rejoindre son Youssouf. «C’est tôt le matin qu’on m’a informé de sa mort. Je ne peux pas dire que je m’y attendais, mais je savais que ça n’allait plus. Que Pakéba n’allait jamais se relever de ce drame.»
Comme tout Diagnon, d’ailleurs. «Je suis resté des mois sans oser m’aventurer seul au dehors, explique le chef du village. Quand on se réunissait le soir, je me mettais toujours au milieu et le moindre bruit me tétanisait de peur. La nuit, je revoyais les images des corps des garçons. Je me réveillais fréquemment en sursaut.» Mais avec le temps, les choses se sont améliorées, Sékou Sané tient mieux le coup. Tout le contraire de Mamadou Camara. Après une tentative de suicide ratée et des mois passés à l’hôpital de Ziguinchor entre les mains des spécialistes, le jeune homme est revenu à la boutique, mais refuse systématiquement de parler de la mort de ses potes. Il vit dans le déni. Comme la plupart des parents des victimes. Pour eux, évoquer le carnage de Bissine, c’est tuer une deuxième fois leurs garçons. C’est faire honneur aux rebelles, qui continuent pourtant de braquer, de tuer et de traumatiser une population casamançaise qui ne n’a que trop souffert des exactions de ces bandes armées. Sans conscience. Sans cœur.
PAPE SAMBARE NDOUR
(ENVOYE SPECIAL A DIAGNON pour L’Observateur)









































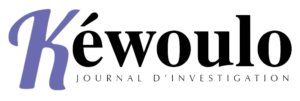













[…] lors de la tuerie de la foret de Diagnon, « plusieurs jeunes de Toubacouta avaient trouvé la mort, tués, disait-on, par des rebelles […]
[…] lors de la tuerie de la foret de Diagnon, « plusieurs jeunes de Toubacouta avaient trouvé la mort, […]
[…] lors de la tuerie de la foret de Diagnon, « plusieurs jeunes de Toubacouta avaient trouvé la mort, […]